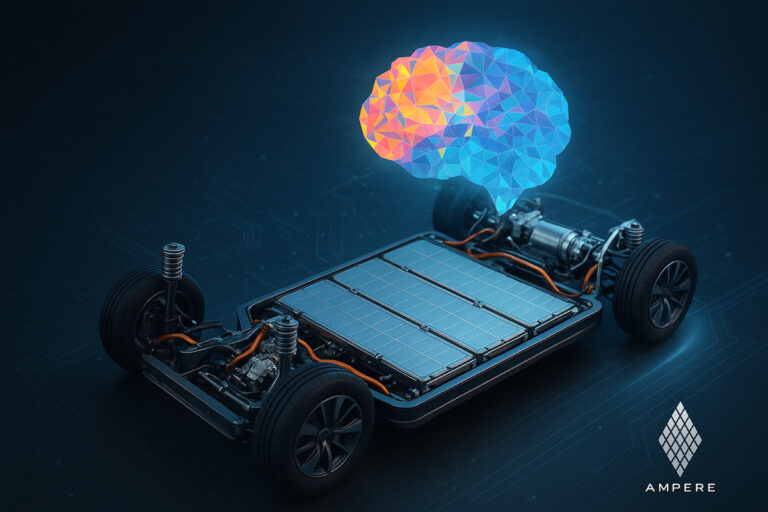Stellantis États-Unis : 10 milliards pour regagner du terrain industriel
Retour de flamme américaine
Pendant plusieurs années, Stellantis a semblé traiter le marché nord-américain comme une chasse gardée sous perfusion.
L’héritage de Fiat Chrysler y assurait des marges confortables grâce à Jeep et Ram, sans véritable stratégie d’investissement industriel.
Les usines vieillissaient, les gammes s’essoufflaient, et les syndicats, notamment l’UAW, multipliaient les signaux d’alerte.
Puis l’usine de Belvidere (Illinois) a fermé, symbole brutal d’un désengagement que beaucoup jugeaient irréversible.
Et soudain, virage à 180 degrés.
Le 4 octobre 2025, Stellantis annonce un plan massif de 10 milliards de dollars d’investissements aux États-Unis.
Objectif : relancer la production, moderniser les sites, et créer de nouveaux emplois.
L’usine de Belvidere rouvrira dès 2027 pour produire un pick-up de gabarit moyen, segment hautement symbolique sur le marché américain.
En parallèle, deux méga-usines de batteries verront le jour à Kokomo (Indiana), fruit d’une coentreprise avec Samsung SDI, soutenue par un prêt fédéral de plus de 7,5 milliards de dollars.
Ce revirement n’est pas anodin.
Il marque la fin d’un cycle : celui du pilotage financier à courte vue, typique des années Carlos Tavares, où la performance industrielle cédait souvent la place à la réduction de coûts.
La fermeture de Belvidere en 2023 avait d’ailleurs été vécue comme un affront dans le Midwest, au point de devenir un cas politique.
Désormais, Stellantis veut regagner le terrain perdu.
Non seulement en rouvrant ses usines, mais surtout en renouant avec l’imaginaire industriel américain : celui du pick-up, du muscle car, et du drapeau étoilé flottant au-dessus d’une chaîne de montage.
Dans un contexte où les tensions commerciales s’aiguisent et où les aides publiques à la production locale s’intensifient, produire aux États-Unis devient autant une nécessité stratégique qu’un acte de légitimation.
Ce retour en force n’est pas un simple ajustement tactique.
C’est un signal adressé à tous : salariés, syndicats, élus, et investisseurs.
Stellantis, longtemps perçu comme un conglomérat européen détaché du terrain américain, veut redevenir un acteur industrielement visible sur le sol des États-Unis.
Et derrière les milliards investis, c’est bien la question de la crédibilité qui se joue.
L’effet Filosa : d’un management financier à une stratégie industrielle
Depuis sa nomination à la tête du groupe en juin 2025, Antonio Filosa impose une inflexion nette.
Ancien responsable de la région Amérique du Nord, il connaît de l’intérieur les limites du modèle hérité de Fiat Chrysler et les fragilités laissées par la gouvernance Tavares.

Ce changement n’a rien d’anecdotique.
L’ère Tavares s’est achevée, mais son empreinte reste visible : une logique fondée sur la réduction des coûts, la standardisation et la concentration des marges sur les modèles les plus rentables.
Une mécanique d’ingénieur, redoutablement efficace sur le papier, mais qui a fini par assécher les bases industrielles locales.
Sa stratégie reposait sur un triptyque bien rôdé : réduction drastique des coûts, standardisation des plateformes et concentration des marges sur les modèles les plus rentables.
Une mécanique d’ingénieur, redoutablement efficace sur le papier, mais qui a fini par assécher les bases industrielles locales.
En Amérique du Nord, les fermetures d’usines, la sous-capacité chronique et les tensions sociales ont entamé la légitimité du groupe face à Ford et General Motors, restés fidèles à la logique du « Build American ».
C’est précisément ce déséquilibre qu’Antonio Filosa entend corriger : replacer la production au centre, non comme un coût mais comme un levier de puissance et de légitimité industrielle.
Le dialogue renoué avec l’UAW et la relance du site de Belvidere s’inscrivent dans cette dynamique : elles réinstallent Stellantis dans le paysage productif américain, à la fois comme employeur et comme acteur politique.
Sa ligne est claire :
relocaliser ce qui donne du sens, externaliser ce qui ne crée plus de valeur.
Cette approche plus pragmatique s’accompagne d’une redéfinition des priorités produits.
Les marques américaines (Jeep, Ram, Dodge) reprennent la main.
Les projets électriques européens à faible rentabilité pour le marché nord-américain sont ralentis, tandis que les investissements lourds se concentrent sur les pick-ups, les SUV et les hybrides rechargeables, seuls capables de générer les volumes nécessaires à court terme.
Mais l’effet Filosa dépasse la tactique industrielle.
Il marque aussi une rupture culturelle au sein de Stellantis : la reconnaissance que le groupe ne peut plus fonctionner comme une fédération de marques dispersées.
Il faut une cohérence d’ensemble, une vision continentale, et une autonomie stratégique régionale. L’Amérique du Nord redevient un pilier, pas un relais de profits pour financer les ambitions européennes.
Ce virage est audacieux, mais nécessaire.
Car dans un contexte de guerre commerciale larvée, ne pas produire sur le sol américain revient à s’en exclure.
Filosa a compris la règle du jeu.
En décidant d’investir massivement, il envoie un message limpide : Stellantis veut redevenir une puissance industrielle américaine, pas seulement un actionnaire européen avec des usines aux États-Unis.
Rebâtir une présence américaine crédible
Le plan de 10 milliards de dollars annoncé par Stellantis n’est pas une pluie de subventions sans cohérence. C’est une reconstruction ciblée, méthodique, de sa base industrielle nord-américaine.
Belvidere : symbole et laboratoire
Fermée en 2023, l’usine de Belvidere (Illinois) devait être condamnée.
C’est désormais le pivot du redressement. Stellantis y investira plusieurs centaines de millions pour produire un nouveau pick-up de taille moyenne, attendu en 2027.
Le choix du segment n’est pas neutre : il s’agit d’un marché en expansion, moins saturé que celui des gros pick-ups Ram 1500, mais plus valorisant que les compacts.
En d’autres termes, un produit de reconquête.
Belvidere devient aussi un symbole politique.
En relançant un site que beaucoup croyaient perdu, Stellantis envoie un message fort au syndicat UAW et aux élus du Midwest : le groupe veut redevenir un employeur industriel, pas seulement un assembleur d’importations.
Plus de 1 500 emplois directs sont annoncés, sans compter les effets d’entraînement sur la filière locale.
Kokomo : la batterie comme levier d’ancrage
À Kokomo (Indiana), Stellantis et Samsung SDI construisent deux usines de batteries d’une capacité combinée de 67 GWh par an, soutenues par un prêt fédéral provisoire de 7,54 milliards de dollars.
Ces sites ne visent pas seulement la production : ils constituent un socle d’indépendance technologique, permettant au groupe de sécuriser ses approvisionnements tout en profitant des incitations de l’Inflation Reduction Act.

C’est un positionnement stratégique subtil.
Plutôt que de se battre sur le front du 100 % électrique pur, Stellantis consolide ses bases hybrides et électrifiées locales, en construisant une infrastructure flexible capable d’alimenter différents niveaux d’électrification.
Cette approche « à géométrie variable » protège le groupe contre les incertitudes réglementaires américaines et les fluctuations de la demande.
Jeep, Ram, Dodge : triptyque de reconquête
Filosa recentre la stratégie produit sur les trois marques américaines historiques : Jeep, Ram et Dodge.
Jeep
Doit redevenir une marque mondiale de SUV à forte valeur ajoutée, en combinant électrification progressive et ADN d’aventure.
Ram
Capitalise sur son image de robustesse pour défendre le cœur du marché américain, celui des pick-ups.
Dodge
En quête d’identité depuis la fin du thermique pur, s’oriente vers une hybridation haute performance, où la technologie sert la continuité émotionnelle.
Derrière ces arbitrages se lit une stratégie claire : réaméricaniser l’offre sans renoncer à la transition énergétique, mais à son rythme.
Là où Ford mise tout sur le F-150 Lightning et GM sur la plateforme Ultium, Stellantis choisit une approche plus prudente, mais potentiellement plus durable : occuper tous les terrains en attendant la consolidation du marché électrique.
Une crédibilité à reconquérir
Pour Stellantis, rebâtir une présence américaine crédible ne passe pas seulement par les usines. Il s’agit aussi de reconstruire une légitimité industrielle auprès des consommateurs, des autorités et des investisseurs.
L’image du groupe reste floue : PSA n’a jamais percé aux États-Unis, Fiat n’y a jamais trouvé sa place, et Chrysler n’a survécu que par fragments.
Le plan Filosa vise précisément à refermer cette fracture identitaire.
En produisant localement, en relançant des modèles emblématiques et en investissant dans la batterie, Stellantis se donne les moyens de redevenir un acteur perçu comme américain, et non comme un étranger de passage.
Un pari politique autant qu’économique
Derrière les milliards annoncés, c’est une manœuvre politique d’une rare finesse.
Stellantis n’investit pas seulement pour produire : il achète sa légitimité dans un marché américain devenu le plus protectionniste depuis des décennies.
Produire pour exister
Depuis l’adoption de l’Inflation Reduction Act (IRA), tout constructeur souhaitant bénéficier des crédits d’impôt sur les véhicules électriques doit produire localement, batteries comprises.
Cette logique de souveraineté industrielle, initiée par l’administration Biden, a bouleversé la carte mondiale de l’automobile.
Ne pas produire sur le sol américain, c’est se condamner à rester spectateur.
Stellantis a d’abord résisté, espérant compenser par l’efficacité de sa chaîne logistique mondiale.
Mauvais calcul : la guerre commerciale larvée entre les États-Unis et la Chine, les menaces de surtaxes sur les importations, et la pression syndicale ont fini par rendre toute autre option intenable.
Le groupe a donc choisi la voie la plus rationnelle : devenir américain pour survivre en Amérique.
Un bouclier politique contre les tempêtes à venir
Les nouveaux investissements ne sont pas seulement des projets industriels : ce sont des pare-feux politiques.
En rouvrant Belvidere et en annonçant des milliers d’emplois dans le Midwest, Stellantis se place dans le camp du « reshoring » vertueux, celui qui plaît aux élus locaux et aux syndicats.
Ce positionnement lui offre une protection précieuse face aux changements de cap possibles après 2025.
Si Trump continue ou même intensifie son virage anti-transition (ce qu’il a déjà commencé à faire), Stellantis peut légitimement revendiquer ses investissements comme un ancrage industriel stratégique, pour protéger ses avantages acquis (prêts fédéraux, subventions, positionnement politique).
Car produire localement en 2025, sous cette administration, n’est pas une option : c’est une condition de survie stratégique.
Le prix de la souveraineté
Mais cette stratégie a un coût : produire aux États-Unis, c’est produire cher.
La main-d’œuvre y est plus coûteuse, les normes sociales plus exigeantes, et les attentes politiques plus fortes.
Pour que le pari soit rentable, Stellantis devra générer des volumes importants et maintenir une qualité perçue irréprochable.
Le marché américain ne pardonne pas les approximations.
Filosa joue donc une partie à haut risque : entretenir la faveur politique sans perdre la rigueur financière.
C’est une équation que peu de groupes automobiles ont su résoudre durablement.
Mais s’il réussit, il offrira à Stellantis ce que la fusion PSA-FCA n’avait pas encore vraiment produit : une cohérence stratégique transcontinentale.
Entre électrification pragmatique et nostalgie thermique
Sous l’administration Trump II, le mot « transition » est devenu suspect.
Washington parle désormais de « réalisme énergétique » et de « souveraineté industrielle », pas d’écologie.
Dans ce contexte, Stellantis se retrouve dans une position paradoxale : investir massivement dans les batteries tout en rassurant une Amérique redevenue thermophile.
Le double discours du pragmatisme
Carlos Tavares l’avait souvent dit : l’électrification ne peut pas être un dogme.
Antonio Filosa, lui, en fait une doctrine d’entreprise.
Le nouveau cap américain s’inscrit dans une logique de coexistence assumée entre moteurs thermiques, hybrides et électriques.
Stellantis ne cherche plus à convaincre Washington de la vertu du VE, mais à s’adapter à la demande réelle : celle d’un marché où le V8 reste un symbole identitaire et où le pick-up électrique n’est encore qu’un produit de niche.
La stratégie est claire : consolider la profitabilité du thermique, préparer le terrain de l’hybride, et laisser le 100 % électrique mûrir sans le forcer.
Cette posture pragmatique permet de continuer à séduire la base conservatrice américaine, tout en conservant un pied dans la transition, un équilibre que Ford et GM, plus exposés médiatiquement, peinent à maintenir.
Le retour du plaisir mécanique
La réédition du Dodge Charger Daytona à propulsion hybride illustre cette tension entre passé et futur. Le modèle conserve la signature sonore du moteur thermique tout en intégrant une électrification légère.
Le message est limpide : on peut aimer les voitures, les vraies, sans renoncer à l’innovation.
Même logique pour Ram, qui mise sur un pick-up hybride rechargeable avant toute version full EV, et pour Jeep, qui renforce ses modèles 4xe plutôt que ses EV purs.
Loin de reculer, Stellantis se repositionne : il ralentit pour durer.
La firme anticipe que le marché américain adoptera le VE à un rythme plus lent, dicté par le pouvoir d’achat, les infrastructures et la psychologie collective.
S’ancrer, pas s’excuser
Sous Trump, afficher des ambitions « vertes » trop visibles serait presque contre-productif.
Stellantis l’a compris : il ne faut plus brandir la transition comme un manifeste idéologique, mais la diluer dans la normalité industrielle.
L’entreprise s’inscrit ainsi dans la rhétorique dominante du moment : produire américain, employer américain, et réduire la dépendance aux importations chinoises, peu importe la couleur de l’énergie.
Ce virage idéologique, loin de freiner Stellantis, le place dans une position habile.
Là où certains groupes européens paraissent en décalage, Filosa compose avec la réalité du terrain : faire de l’écologie sans prononcer le mot.
Une transition en sous-texte
Le pragmatisme de Stellantis n’est donc pas une trahison de la transition énergétique, mais une forme de camouflage stratégique. Les investissements dans les batteries, l’hybridation et la relocalisation des chaînes d’approvisionnement posent les fondations d’un futur électrifié, même si la communication publique s’en défend.
En somme, Stellantis ne rompt pas avec la transition : il la rend compatible avec le trumpisme.
Vers une souveraineté américaine de Stellantis ?
Ce que Stellantis est en train de construire aux États-Unis dépasse la simple relance industrielle.
C’est une mutation de pouvoir interne : l’amorce d’une souveraineté américaine au sein d’un groupe né en Europe.
Une Amérique qui ne veut plus dépendre
L’histoire industrielle américaine est faite de cycles d’orgueil et de dépendance.
Pendant des décennies, Chrysler a survécu sous perfusion étrangère : d’abord Daimler, puis Fiat.
Avec Stellantis, on assistait à une fusion de plus et à une dilution d’identité.
Or, les investissements récents inversent la dynamique : ce n’est plus l’Europe qui vient sauver l’Amérique, mais l’Amérique qui sert désormais de socle de relance au groupe.
En installant des gigafactories, en relançant Belvidere et en concentrant les efforts sur Jeep, Ram et Dodge, Antonio Filosa redonne à la branche US une autonomie stratégique et financière.
Les usines américaines produisent, les profits américains financent, et bientôt, les technologies américaines, batteries, logiciels, plateformes hybrides, pourraient s’imposer comme le standard du groupe.
Le glissement du centre de gravité
Stellantis s’est toujours voulu un assemblage équilibré : Italie, France, États-Unis.
Mais dans les faits, le centre de gravité est en train de basculer vers le continent américain.
Les usines européennes ferment ou se reconvertissent sous pression réglementaire, les marges s’érodent sur les petits véhicules électriques, et les ventes asiatiques restent marginales.
À l’inverse, les États-Unis offrent un terrain fertile : aides massives, marché solvable, protectionnisme favorable.
Ce renversement pose une question fondamentale : que restera-t-il du Stellantis européen dans dix ans ?
Si la branche nord-américaine devient le moteur du groupe, tant sur le plan économique que politique, l’Europe pourrait se retrouver cantonnée à un rôle de laboratoire technologique, utile mais périphérique.
Une fragmentation stratégique en germe
Cette souveraineté américaine interne n’est pas sans risque.
En se calant sur la doctrine trumpiste du « produire national », Stellantis s’expose à une tension permanente : celle d’un groupe global tenté par la balkanisation de sa stratégie.
Un Stellantis américain centré sur le pick-up et la marge courte.
Un Stellantis européen obsédé par le CO₂ et la micro-voiture électrique.
Deux logiques industrielles qui s’éloignent, deux narrations de marque qui se contredisent.
Pour l’instant, Filosa maintient l’équilibre : il parle d’« adaptation régionale ».
Mais à long terme, la cohérence du groupe dépendra d’une question simple : qui dictera la feuille de route ?
Paris et Turin, ou Detroit et Kokomo ?
Un groupe mondial, ou deux hémisphères industriels ?
L’enjeu est là : Stellantis peut devenir le premier constructeur réellement bi-continental, assumant deux modèles énergétiques, deux cultures industrielles, deux visions du monde.
Ou il peut éclater sous la pression des divergences politiques et réglementaires.
Le tournant américain est donc à la fois une renaissance et une mise à l’épreuve : celle de savoir si un conglomérat issu d’un mariage de raison peut se transformer en fédération stratégique cohérente.
Filosa a rallumé les moteurs.
Reste à voir si le groupe saura tenir son cap dans la tempête idéologique que traverse le monde automobile.

Conclusion – Le pari américain de Stellantis : audace ou fragmentation ?
Ce que fait Stellantis aujourd’hui aux États-Unis n’est pas un simple plan d’investissement industriel. C’est un changement de matrice stratégique : passer d’une logique de synergie mondiale à une architecture géopolitique par blocs.
Antonio Filosa ne se contente pas de relancer une usine, il rebat les cartes d’un groupe longtemps prisonnier de sa logique de fusion. Là où Tavares rationalisait, Filosa relocalise.
Là où Stellantis se voulait global, il devient plurirégional, un groupe à souverainetés multiples.
Synthèse : un basculement en trois actes
- 2023–2024 : désindustrialisation silencieuse. Fermeture de Belvidere, tensions sociales, perception d’un groupe européen détaché du terrain américain.
- 2025 : inflexion Filosa. 10 milliards d’investissements, 2 gigafactories, retour du dialogue syndical, recentrage sur Jeep/Ram/Dodge.
- 2026–2030 : l’ère du réalisme énergétique. Hybridation massive, prudence sur le VE, repositionnement nationaliste assumé sous administration Trump.
| Dimension | Forces et opportunités | Faiblesses et risques | Perspectives 2026–2030 |
|---|---|---|---|
| Industriel | Relocalisation productive, modernisation des sites (Belvidere, Kokomo), dialogue UAW stabilisé, ancrage fournisseurs. | Dépendance aux aides fédérales, coûts salariaux élevés, complexité multi-continents, ramp-up sensible. | Consolidation d’un pôle US autonome et scalable, effets d’entraînement sur la filière Midwest. |
| Technologique | JV batteries avec Samsung SDI, capacité ~67 GWh/an, architecture multi-énergies (thermique, HEV, PHEV, BEV). | Retard relatif sur le VE pur et sur l’intégration logicielle bout-en-bout, risque d’obsolescence rapide. | Plateformes flexibles et évolutives, montée progressive du mix électrifié selon la demande réelle. |
| Commercial | Triptyque Jeep, Ram, Dodge performant, retour du pick-up moyen, pricing power sur SUV/pick-up. | Image globale hétérogène, pression concurrente asiatique sur l’électrique abordable, volatilité de la demande. | Repositionnement marketing US fort, segmentation mentale locale, hybridation comme pont vers le VE. |
| Politique | Alignement tactique « produire américain », emplois locaux, capital symbolique auprès des élus et syndicats. | Dépendance au cycle politique, remise en cause possible des incitations, aléas réglementaires inter-États. | Bouclier d’acceptabilité grâce à l’ancrage local, capacité à pivoter selon l’administration en place. |
| Géostratégique | Sécurisation du marché US, diversification des profits hors Europe, réduction de l’exposition import. | Fragmentation interne possible entre pôles US et UE, duplication d’efforts technologiques. | Vers un Stellantis bicéphale : Amérique = rentabilité industrielle, Europe = innovation normative et R&D. |
Projection stratégique : le scénario des deux hémisphères
Scénario optimiste (fusion maîtrisée)
Stellantis parvient à maintenir un équilibre entre ses deux pôles.
Les gigafactories US alimentent une montée en gamme technologique, les plateformes restent compatibles entre continents, et le groupe devient un modèle d’adaptation régionale réussie.
→ Un constructeur biculturel, pas schizophrène.
Scénario central (dissociation fonctionnelle)
Le groupe conserve un pilotage commun, mais les stratégies divergent :
- les États-Unis privilégient le thermique et l’hybride,
- l’Europe s’enferme dans la réglementation carbone.Chacun optimise son marché, au détriment de la cohérence globale.→ Un Stellantis à deux vitesses, rentable mais sans vision commune.
Scénario pessimiste (fragmentation politique)
La logique protectionniste s’intensifie, les normes divergent, les marques se replient. Le groupe devient un conglomérat d’intérêts régionaux, sans synergie technologique.
→ La fin du rêve d’un constructeur mondial intégré.
Ce que l’avenir dira
Dans le fond, Stellantis joue le même pari que Chrysler dans les années 1950 : être plus américain que les Américains eux-mêmes.
Mais cette fois, il le fait en pleine transition énergétique, au moment où les équilibres politiques se recomposent.
Filosa a saisi la nouvelle règle du jeu : la souveraineté n’est plus une option, c’est une condition d’accès au marché.
La question n’est plus de savoir si Stellantis survivra, mais sous quelle bannière.
Celle d’un groupe global, ou celle d’un empire industriel à deux capitales : Paris et Detroit.
Chaque article part d’un document officiel (fiche produit, communiqué, rapport) pour en extraire les lignes de force industrielles, symboliques ou politiques. Une lecture rigoureuse, stratégique et sans naïveté.
Ces cinq fils rouges (Sillages) traversent mes publications :
Cartographie des segments, Distribution & Économie, Marketing du VE, Marques & Modèles, Technologies du VE.
Une réaction, un désaccord, une idée ?
Cliquez sur la bulle 💬 rose en bas à gauche pour laisser un commentaire.
Je lis tout. Je réponds toujours.
Envie de faire circuler cet article ?
Vous pouvez le partager via les icônes en haut ou en bas de cette page.
Envie de suivre les prochaines publications ?
→ S’abonner à la newsletter

Léon Chelli arpente les mondes de l’automobile et des énergies renouvelables à travers la transition écologique. Il y déchiffre mutations industrielles et stratégies de marché avec la lucidité un peu sauvage d’un promeneur qui choisit ses propres sentiers.
Il explore les transitions avec une vision systémique, entre ironie assumée et clarté analytique.