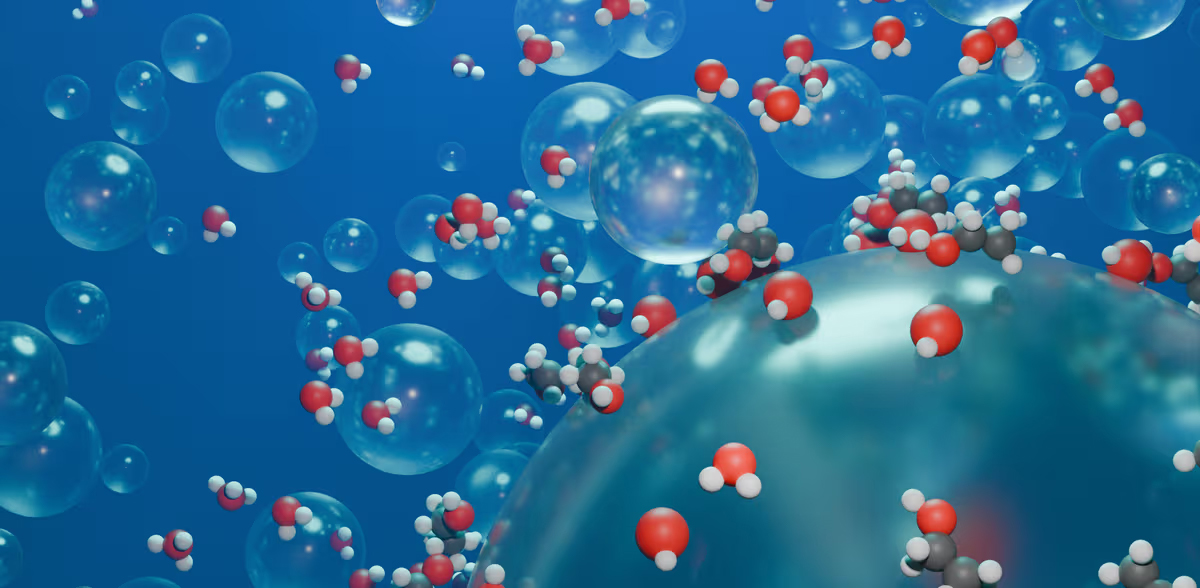Nanobulles industrielles : une révolution silencieuse pour l’énergie propre
Dans l’univers feutré des technologies dites de rupture, certaines innovations ne font pas de bruit. Littéralement.
Pas d’armoire connectée ni de promesse de ‘disruption’.
Juste des bulles invisibles, plus petites que des virus, capables de transformer la performance de matériaux industriels sans changer leur composition.
C’est le pari de Moleaer Inc., qui a réussi à intégrer des milliards de nanobulles dans des films minces utilisés dans les batteries, piles à combustible, électrolyseurs ou membranes de filtration.
Une technologie simple, élégante, et surtout compatible avec les lignes de production existantes.
Nanobulles : qu’est-ce que c’est ?
Une nanobulle, c’est une bulle de gaz mille fois plus petite qu’un cheveu humain (épaisseur, hein, pas longueur).
Elle ne flotte pas, ne remonte pas, ne claque pas en surface.
Elle reste en suspension, là où on la place, et interagit avec les matériaux comme un lubrifiant diffus, modifiant la structure microscopique sans perturber le support.
Ces bulles peuvent être injectées dans un liquide, puis intégrées à un revêtement mince appliqué sur des supports industriels.
Leur intérêt ?
Améliorer la porosité, la régularité et la surface active sans changer la composition chimique du matériau.
Autrement dit : on augmente les performances sans toucher à la recette. Une aubaine pour les industriels.
Une intégration sans rupture
C’est là l’élégance du procédé Moleaer : les nanobulles ne nécessitent aucune rupture technologique.
Leur intégration est possible sans modifier les matériaux ni les lignes de production. Elles s’intègrent dans les encres, vernis ou revêtements existants, comme on ajoute un catalyseur invisible dans une chaîne rodée.
En termes industriels, cela signifie un gain de performance immédiat, sans coût massif de reconception.
C’est toute la différence entre une technologie séduisante en labo et une solution scalable.
Des performances spectaculaires
Les résultats annoncés par Moleaer sont à la fois crédibles et impressionnants :
- +66 % de perméabilité sur les membranes de filtration,
- +20 % de puissance pour les piles à combustible,
- +17 % de densité de courant dans les électrolyseurs,
- Et pour les batteries lithium-ion : des cycles plus rapides, une meilleure régularité, une durée de vie accrue.
Des gains qui ne relèvent pas du gadget.
Dans un monde d’efficacité énergétique et d’optimisation des coûts, chaque pourcentage gagné sans modification matérielle est un levier stratégique.
Batteries, hydrogène, eau : des secteurs en ligne directe
Cette technologie a un potentiel évident dans trois domaines clés :
- Le stockage d’énergie, où les films minces à base de lithium-ion profitent directement d’une meilleure densité de courant et d’une stabilité renforcée.
- L’hydrogène vert, où électrolyseurs et piles à combustible bénéficient à la fois de performances accrues et de coûts abaissés.
- Le traitement de l’eau, qui reste l’un des terrains historiques des nanobulles, notamment pour la filtration fine et la réduction de biofilms.
Et demain ?
La cosmétique, l’agroalimentaire ou même les semi-conducteurs pourraient s’y intéresser.
Partout où une fine couche technique doit combiner régularité, efficacité et conductivité, ces bulles invisibles peuvent faire la différence.
Une soft tech qui change la donne
L’innovation portée par Moleaer ne repose ni sur une rupture matérielle, ni sur une prouesse algorithmique.
Elle incarne une nouvelle forme de ‘soft tech’ industrielle : discrète, efficace, compatible, sobre.
Et si l’avenir de l’industrie propre passait aussi par là ?
Par des améliorations incrémentales, mais systémiques, qui décuplent les effets sans alourdir les processus.
Parfois, la révolution tient dans une bulle.
Toute petite, en plus !
🔋 Et pour la batterie automobile, concrètement ?
L’électromobilité repose sur une course constante à l’efficacité : autonomie, densité énergétique, longévité.
Or, l’intégration de nanobulles dans les films minces des batteries lithium-ion pourrait répondre à plusieurs enjeux-clés du secteur :
- Réduction de la résistance interne → meilleure conductivité, donc recharge plus rapide.
- Régularité des couches actives → moins de points faibles, donc plus de cycles sans perte de capacité.
- Optimisation thermique passive → moins de dégagement de chaleur, donc plus de sécurité.
Le tout sans changer ni la chimie, ni la ligne de production.
Autrement dit, un levier de compétitivité immédiat pour les gigafactories, et une innovation invisible qui pourrait faire gagner quelques précieux pourcents à l’autonomie réelle des VE… sans que l’utilisateur final ne s’en rende compte.
Pour aller plus loin
Pour celles et ceux qui souhaitent explorer plus en profondeur les effets des nanobulles sur les matériaux, les interfaces et les électrodes, voici une sélection d’articles techniques et académiques récents :
- Optimisation des électrodes via nanostructures et nanobulles — Development of Micro-Nano Structured Electrodes for Enhanced Reactivity: Improving Efficiency Through Nano-Bubble Generation – → Lire l’étude sur MDPI
- Rôle des nanobulles dans la récupération de matériaux d’électrodes lithium-ion — Enhancement effect of interfacial nanobubbles on flotation performance of electrode materials from lithium-ion batteries – → Accéder à l’article (MTXB, en anglais)
- Contrôle de la mouillabilité pour optimiser la nucléation des nanobulles — Tuning Electrode Wettability to Optimize Nanobubble Nucleation and Reaction Rates in Electrochemical Gas-Evolving Reactions – → Consulter sur arXiv
Ces cinq fils rouges (Sillages) traversent mes publications :
Cartographie des segments, Distribution & Économie, Marketing du VE, Marques & Modèles, Technologies du VE.
Une réaction, un désaccord, une idée ?
Cliquez sur la bulle 💬 rose en bas à gauche pour laisser un commentaire.
Je lis tout. Je réponds toujours.
Envie de faire circuler cet article ?
Vous pouvez le partager via les icônes en haut ou en bas de cette page.
Envie de suivre les prochaines publications ?
→ S’abonner à la newsletter

Léon Chelli arpente les mondes de l’automobile et des énergies renouvelables à l’épreuve de la transition écologique.
Il y déchiffre mutations industrielles et stratégies de marché avec la lucidité un peu sauvage d’un promeneur qui choisit ses propres sentiers.
Il explore les transitions avec une vision systémique, entre ironie assumée et clarté analytique.