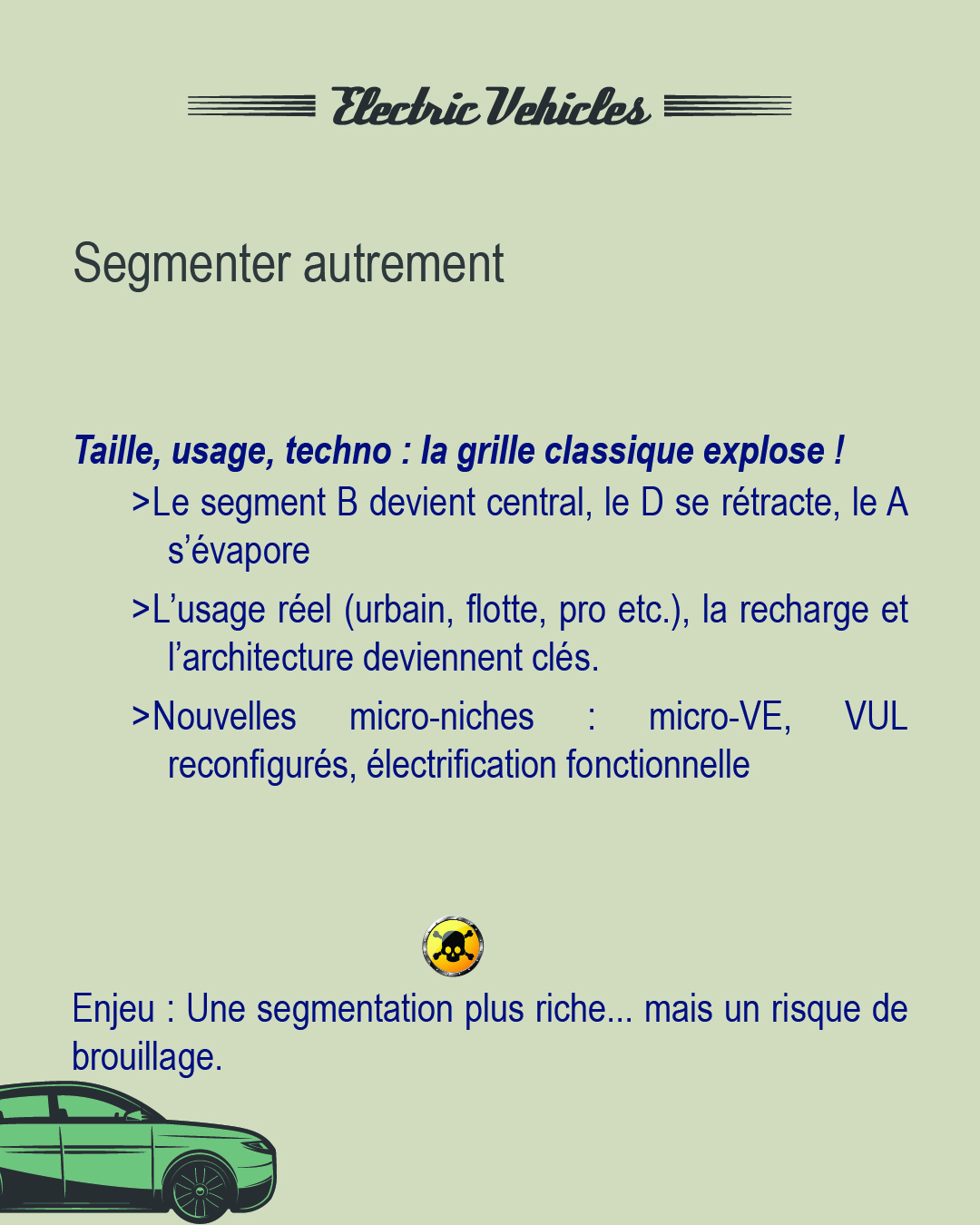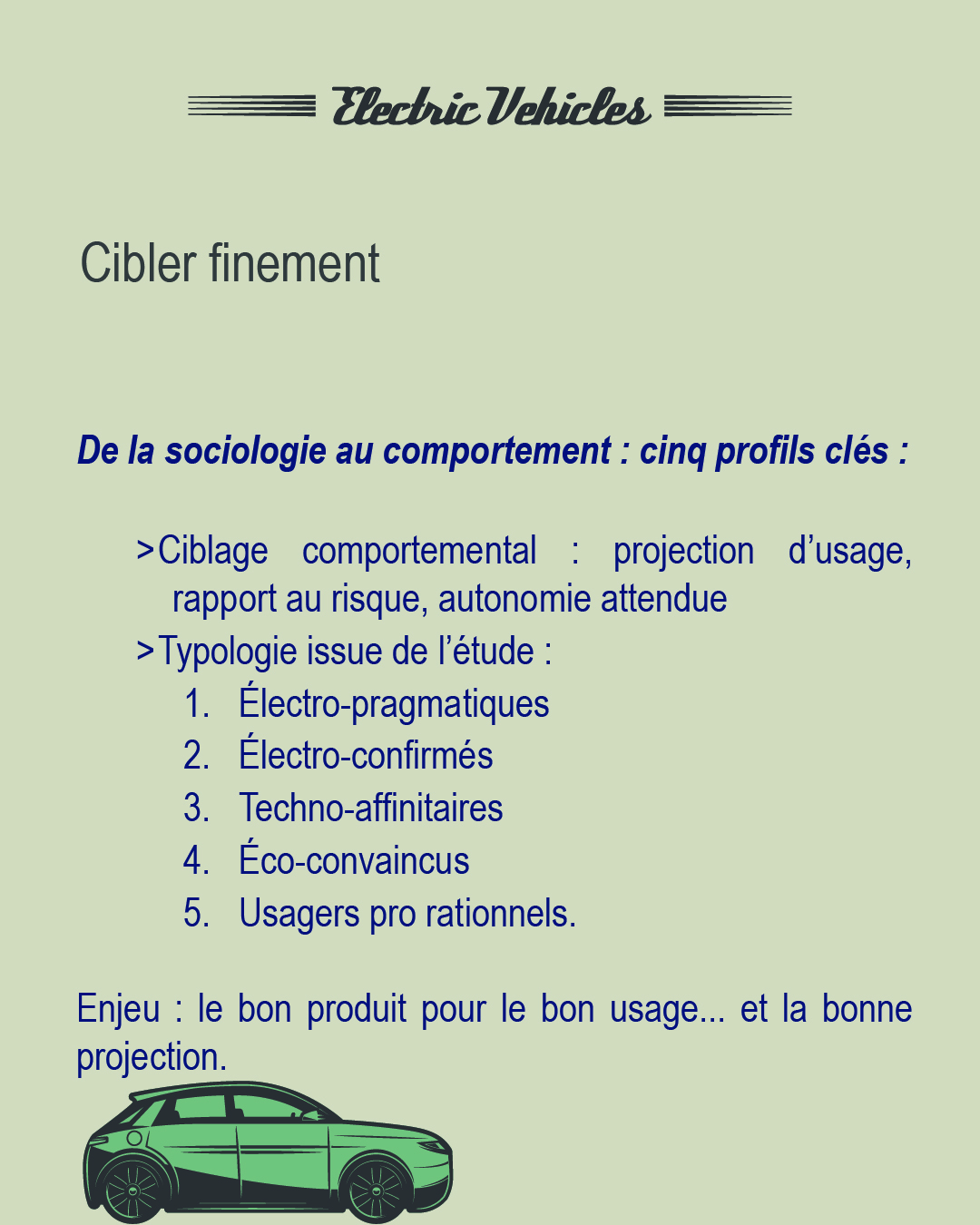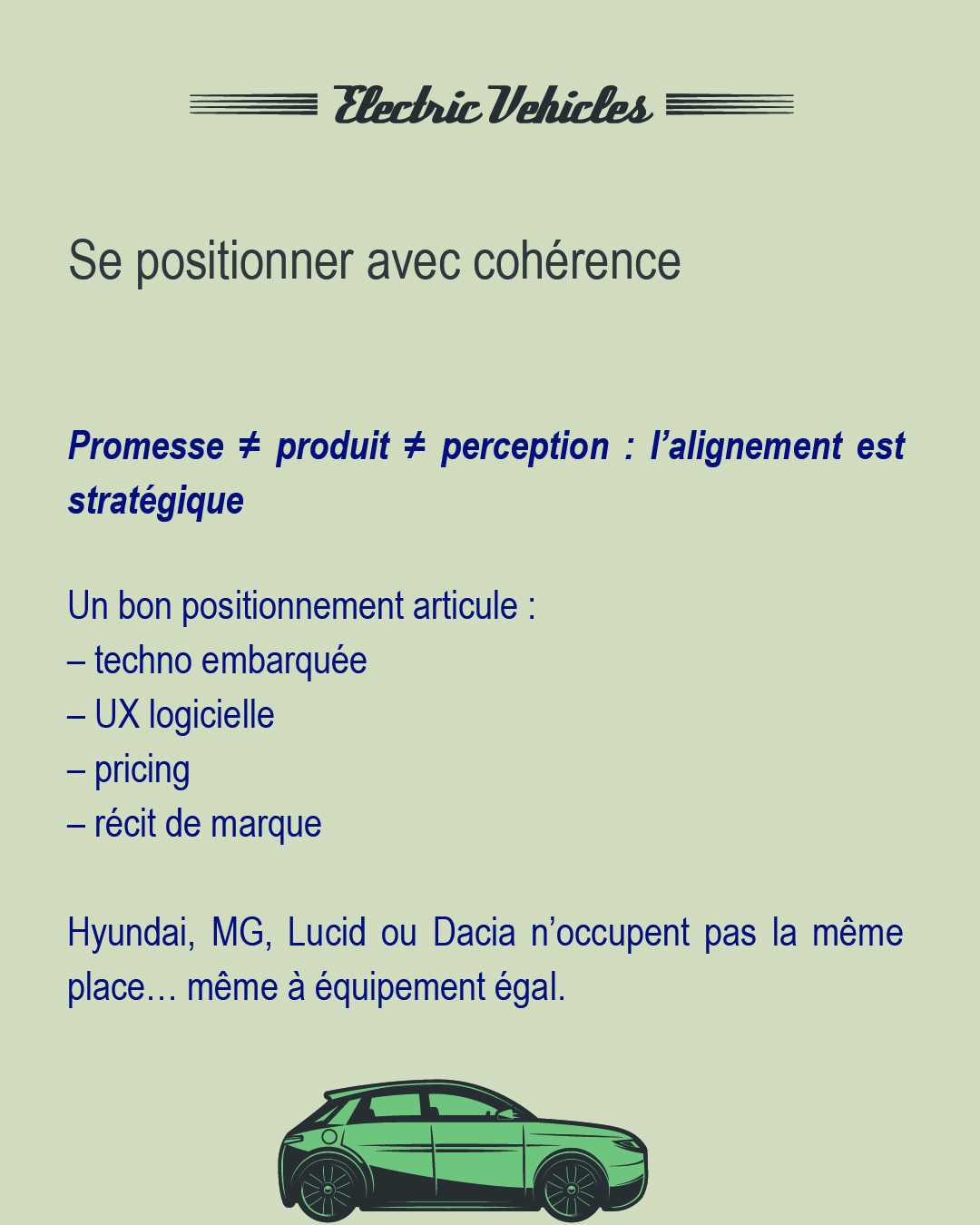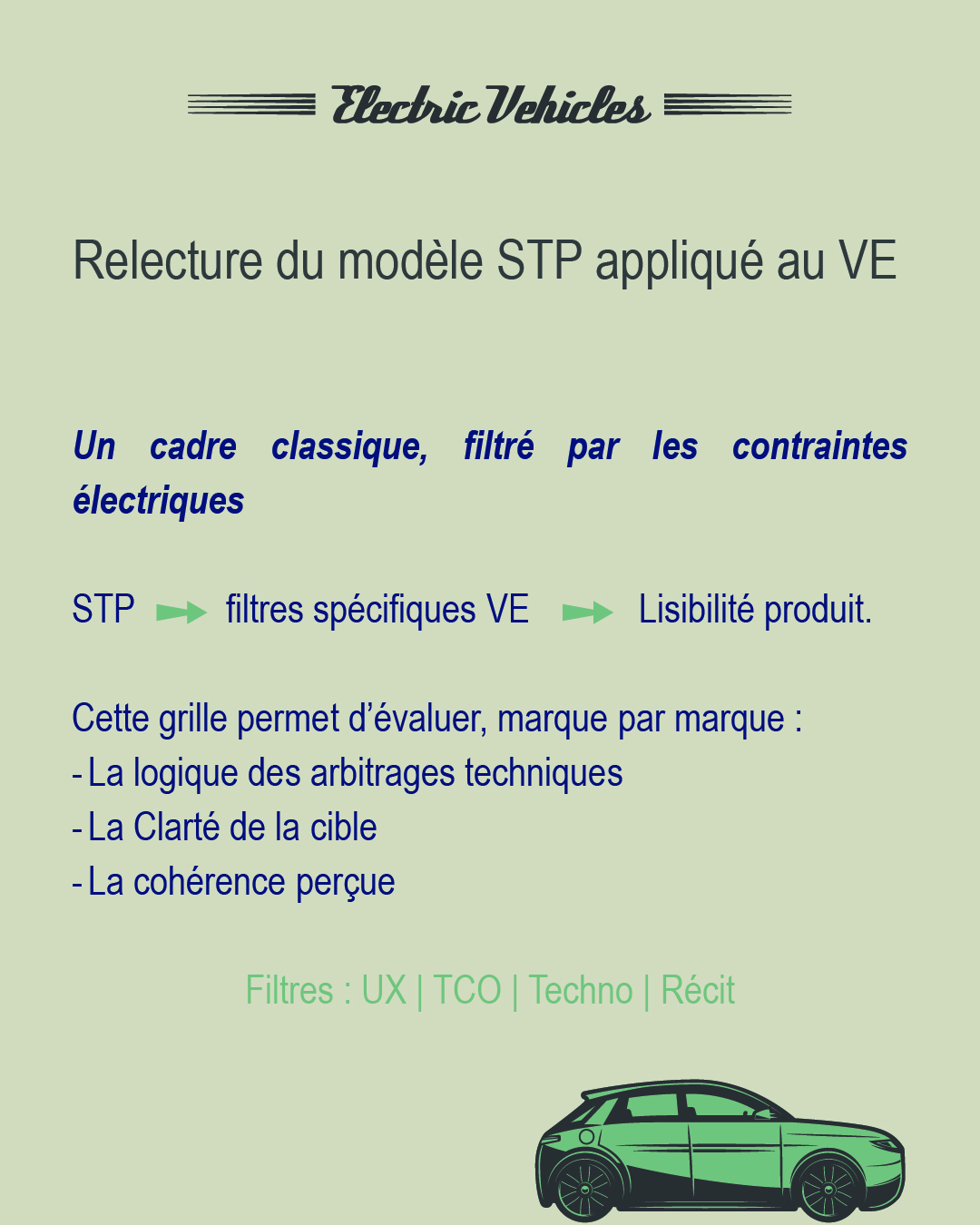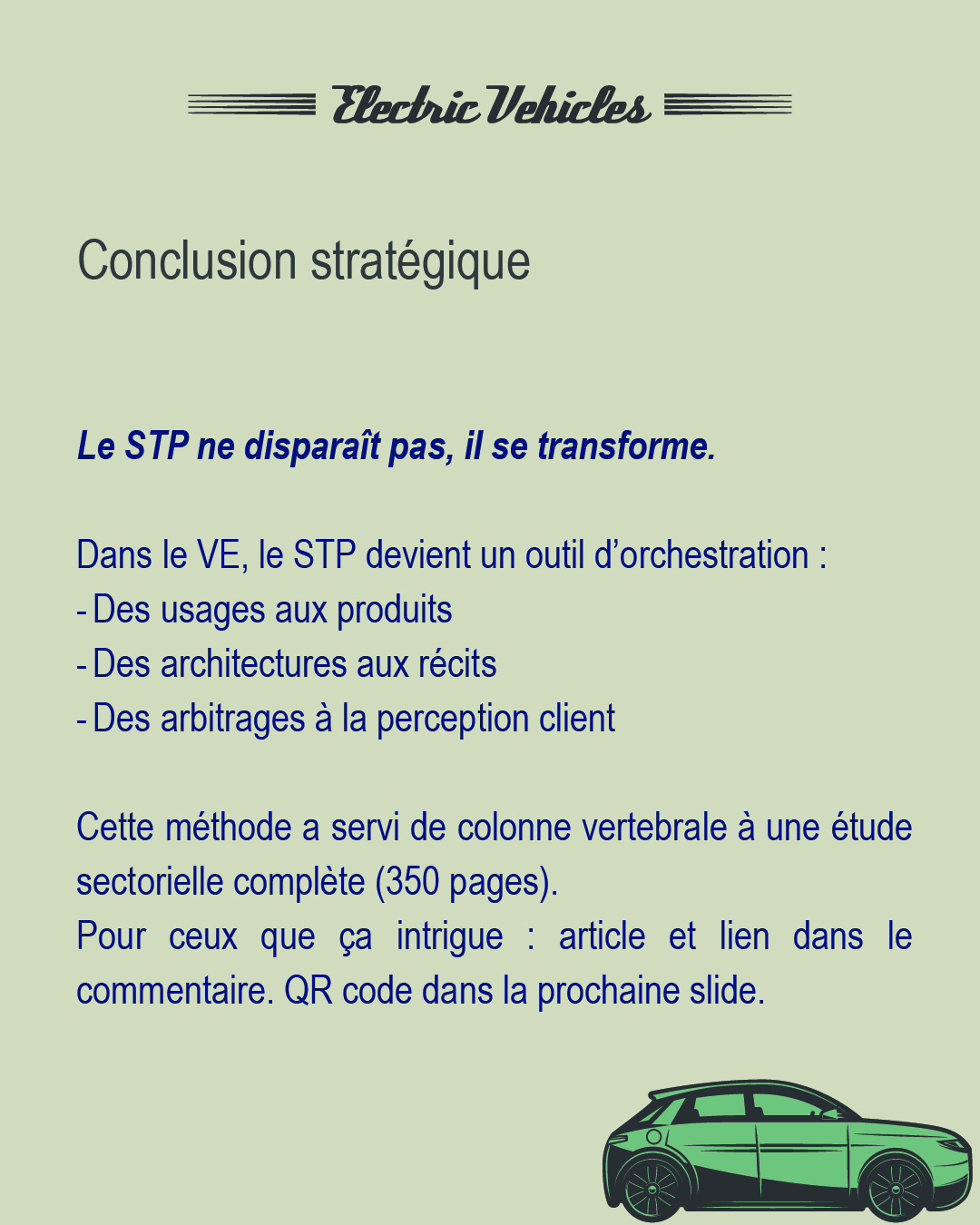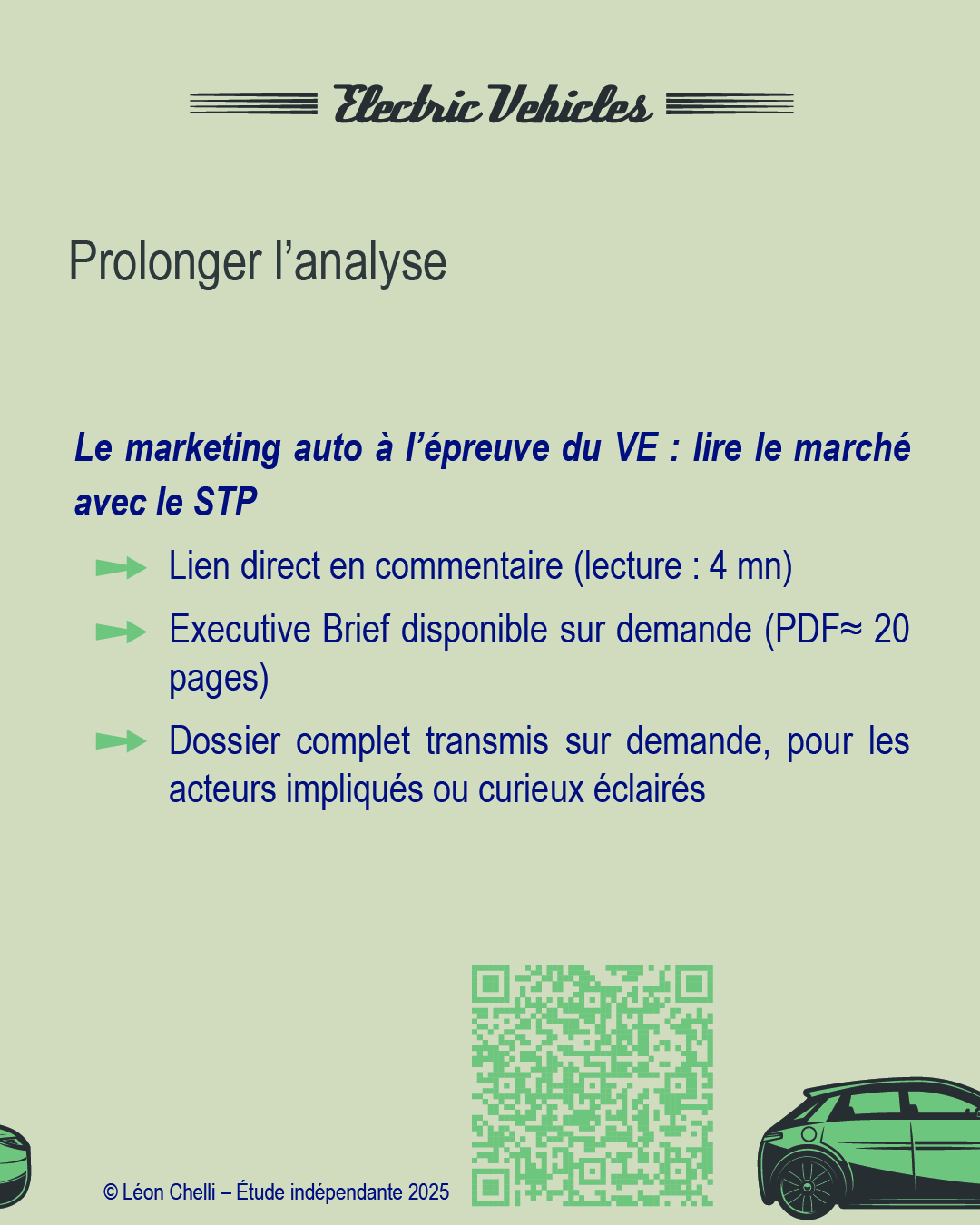Le marketing automobile à l’épreuve du véhicule électrique : réinventer le modèle STP
Le marketing automobile repose depuis des décennies sur une grille simple et redoutablement efficace : STP — Segmentation, Targeting, Positioning.
Une trinité stratégique qui a façonné des générations de lancements produits, dicté les arbitrages entre modèles et guidé la construction des marques.
Mais appliqué au véhicule électrique, ce cadre classique ne tient plus.
Parce que la logique du thermique n’est pas transposable. Parce que les variables de choix ont changé. Parce qu’entrer dans l’ère électrique, c’est accepter de tordre les outils traditionnels pour leur donner un autre sens.
Segmenter autrement : usages, recharges, architectures
La segmentation automobile reposait hier sur des critères clairs : taille des véhicules, positionnement prix, segmentations A-B-C-D-E héritées des codes européens.
Mais l’arrivée du VE fait exploser cette grille de lecture.
- Le segment B devient central, parce qu’il offre le meilleur compromis autonomie / prix / polyvalence.
- Le segment D se rétracte, fragilisé par des coûts trop élevés et une clientèle hésitante.
- Le segment A s’évapore presque, laminé par les contraintes réglementaires et les marges impossibles.
À la place émergent d’autres critères :
- Usage réel (urbain, flotte professionnelle, grands trajets occasionnels, VUL réinventés)
- Accès à la recharge (domicile, borne publique, recharge rapide)
- Architecture technologique (400 V ou 800 V, batteries LFP ou NMC, etc.)
La segmentation devient fonctionnelle et technologique, non plus seulement dimensionnelle.
Et de nouvelles micro-niches apparaissent : micro-VE urbains, utilitaires électriques reconfigurés, modèles conçus pour l’autopartage.
Enjeu : une segmentation plus riche, mais aussi un risque de brouillage si l’offre devient illisible pour le client.
Cibler différemment : des comportements, pas seulement des profils
Dans le thermique, on ciblait des catégories sociologiques, des CSP+, des familles, des urbains ou des ruraux.
Dans l’électrique, le ciblage devient comportemental : ce qui compte, ce n’est pas seulement qui vous êtes, mais comment vous vivez la mobilité.
L’étude sectorielle menée en avril 2025 a fait émerger cinq profils principaux :
- Électro-pragmatiques : regardent le coût total (TCO), veulent un outil fiable, sans surpromesse.
- Électro-confirmés : déjà utilisateurs, convaincus, parfois prosélytes.
- Techno-affinitaires : séduits par la dimension logicielle, l’innovation, le “wow effect”.
- Éco-convaincus : choisissent le VE pour des raisons environnementales et militantes.
- Usagers pro-rationnels : entreprises, flottes, utilitaires cherchant un équilibre coûts / bénéfices.
Cette typologie ne remplace pas les segmentations classiques, mais elle surdétermine les comportements d’achat.
Elle explique pourquoi deux clients de même âge, même revenu, même localisation, font des choix totalement opposés selon leur rapport au risque, leur expérience de la recharge ou leur perception de l’autonomie.
Positionner avec cohérence : aligner promesse, techno et récit
Le positionnement n’est plus un simple slogan.
Dans l’électrique, il repose sur l’alignement entre quatre dimensions :
- Promesse produit (autonomie, performance, polyvalence)
- Technologie embarquée (batteries, puissance de recharge, architecture)
- UX logicielle (interfaces, mises à jour OTA, services connectés)
- Récit de marque (écologique, statutaire, populaire, premium)
Hyundai, MG, Lucid ou Dacia n’occupent pas la même place dans l’imaginaire collectif, même avec un équipement équivalent.
Un bon positionnement articule donc cohérence technologique et récit de marque. Faute de quoi, le client détecte l’écart et sanctionne la marque.
Relecture du modèle STP : un outil de lisibilité produit
Revisité, le modèle STP devient un filtre analytique appliqué aux VE.
Il permet d’évaluer marque par marque :
- La logique des arbitrages techniques (cohérence entre choix batterie, recharge, motorisation)
- La clarté de la cible (à qui s’adresse le véhicule, et est-ce lisible ?)
- La cohérence perçue (promesse tenue, crédibilité du récit)
Autrement dit : un outil de lisibilité stratégique.
Parce que dans un marché brouillé, ce qui manque aux clients comme aux investisseurs, c’est de la lisibilité.
Une méthode éprouvée sur plus de 50 marques et environ 250 modèles
Cette grille STP revisitée a servi de colonne vertébrale à l’étude sectorielle sur le VE en France (avril 2025) :
- 50 marques analysées
- 250 modèles passés au crible
- 350 pages de synthèse
Le résultat : une cartographie des tensions stratégiques, entre arbitrages industriels, récits de marque et réalités techniques.
Conclusion : le STP ne disparaît pas, il se transforme
Appliqué au thermique, le STP servait de cadre simple pour orchestrer segmentation, ciblage et positionnement.
Appliqué au VE, il devient un outil d’orchestration des tensions :
- Des usages aux produits
- Des architectures aux récits
- Des arbitrages à la perception client
Un modèle classique, réinterprété à l’épreuve de la transition.
En somme : le STP n’est pas mort. Il s’est déplacé.
De la simple case marketing à l’outil d’analyse systémique, il devient un prisme pour comprendre la recomposition d’un marché en transition.
Pour aller plus loin
Documents d’analyse
- Executive Brief (≈ 20 pages) disponible sur demande – Télécharger le document
- Dossier complet (350 pages, PDF protégé) accessible sur demande motivée, à la suite de l’article complet en lecture libre ici – Consulter l’article
Ces cinq fils rouges (Sillages) traversent mes publications :
Cartographie des segments, Distribution & Économie, Marketing du VE, Marques & Modèles, Technologies du VE.
Une réaction, un désaccord, une idée ?
Cliquez sur la bulle 💬 rose en bas à gauche pour laisser un commentaire.
Je lis tout. Je réponds toujours.
Envie de faire circuler cet article ?
Vous pouvez le partager via les icônes en haut ou en bas de cette page.
Envie de suivre les prochaines publications ?
→ S’abonner à la newsletter

Léon Chelli arpente les mondes de l’automobile et des énergies renouvelables à travers la transition écologique. Il y déchiffre mutations industrielles et stratégies de marché avec la lucidité un peu sauvage d’un promeneur qui choisit ses propres sentiers.
Il explore les transitions avec une vision systémique, entre ironie assumée et clarté analytique.