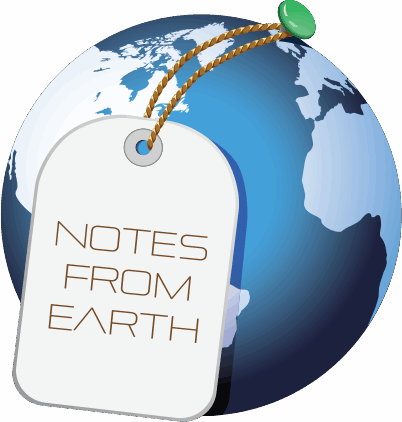Jésus, juif de gauche
Exégèse politique d’un contresens historique
Ce texte ne s’adresse pas aux catéchumènes trop zélés, ceux pour qui la ferveur tient lieu de méthode et la répétition de pensée.
Il suppose un lecteur adulte, disposé à lire un texte ancien sans l’embaumer, à en accepter la rugosité, les aspérités, les silences, et à admettre qu’un message spirituel puisse être, aussi, profondément politique.
Ce travail s’appuie exclusivement sur la traduction biblique d’André Chouraqui.
Ce choix n’a rien d’esthétique ni de confessionnel.
Il est méthodologique.
Chouraqui, helléniste et hébraïsant rigoureux, s’est attaché à restituer les textes au plus près de leur langue d’origine, en résistant autant que possible à la tentation de l’interprétation, de l’adoucissement théologique ou de la mise en musique liturgique.
Sa traduction est parfois âpre, souvent déroutante, presque austère. C’est précisément sa force. Elle rend au texte biblique sa densité première, son étrangeté, son ancrage historique, et, surtout, sa charge conflictuelle.
Car aucun texte ne naît hors-sol.
Les Évangiles s’inscrivent dans un contexte historique, social et géographique précis : la Judée du Ier siècle, province dominée de l’Empire romain, traversée de tensions religieuses, économiques et politiques constantes.
Jésus y est nécessairement juif, nécessairement situé, nécessairement incarné. Basané, provincial, parlant l’araméen, pétri de la tradition prophétique, étranger à toute idée de chrétienté à venir.
Rien à voir avec la figure pâle, longiligne et vaguement occidentale que l’iconographie tardive a figée, quelque part entre imagerie pieuse et fantasme hollywoodien.
Lire les Évangiles ainsi, c’est refuser le confort de la légende.
C’est accepter de se confronter à une parole située, charnelle, parfois brutale, qui parle de Dieu, certes, mais qui parle aussi d’argent, de pouvoir, de domination, de justice sociale. Et qui le fait sans détour, sans prudence rhétorique, sans souci de consensus.
Une pensée religieuse située, sociale et conflictuelle
Lire les Évangiles comme des textes hors-sol, détachés de toute matérialité historique, revient à les neutraliser.
Le propos ici n’est ni théologique au sens confessionnel, ni militant au sens contemporain.
Il s’agit d’une lecture historique et sociale des textes, attentive à leur langue, à leur contexte et aux rapports de force qu’ils traversent.
Jésus n’est pas convoqué comme une figure morale universelle, mais comme un homme situé, parlant depuis un monde structuré par l’occupation, la domination économique, les hiérarchies religieuses et les fractures sociales.
Ce que disent les Évangiles ne peut être compris qu’à cette condition : accepter que le spirituel, dans ces textes, n’est jamais séparé du politique.
1. Jésus n’est pas chrétien
Dire que Jésus n’est pas chrétien n’est pas une provocation, mais un point de départ méthodologique.
Le christianisme n’existe pas encore.
Jésus est juif, et il l’est pleinement, historiquement, théologiquement, socialement.
Sa parole, ses gestes, ses références, son imaginaire symbolique sont intégralement enracinés dans le judaïsme du Second Temple.
Il parle l’araméen, prie le Dieu d’Israël, fréquente la synagogue, cite la Torah et les Prophètes.
Lorsqu’il parle de Dieu, il ne l’invente pas.
Il se situe dans une tradition précise, mais une tradition conflictuelle : celle des prophètes.
Une tradition qui ne cherche jamais à pacifier le monde, mais à le mettre en accusation.
Dans le judaïsme du Second Temple, le prophète n’est ni un sage consensuel, ni un administrateur du sacré.
Il ne gère pas l’ordre existant, il le met en cause.
Il ne parle pas au nom des institutions, mais contre elles, lorsque celles-ci trahissent leur fonction.
La parole prophétique ne vise pas l’harmonie sociale, mais la vérité.
Elle dérange les puissants, inquiète les autorités religieuses et expose les compromissions.
Se situer dans cette lignée, comme Jésus le fait explicitement, revient à assumer une conflictualité structurelle avec l’ordre établi.
Lorsque Jésus ouvre publiquement son activité, il ne choisit pas un texte neutre.
Il lit Isaïe et s’y identifie explicitement :
‘L’esprit de IHVH-Adonaï est sur moi, car il m’a messianisé pour annoncer aux pauvres’.
Isaïe 61, 1 repris en Luc 4, 18–19, trad. Chouraqui
Ce passage est décisif.
D’abord parce qu’il définit la mission de Jésus en termes sociaux avant toute chose.
Les pauvres ne sont pas ici une métaphore spirituelle.
Dans la Bible hébraïque, le pauvre est celui qui est vulnérable, dépendant, exposé à l’arbitraire des puissants.
Annoncer quelque chose aux pauvres, c’est prendre position dans un rapport de forces.
Ensuite parce que Jésus se place consciemment dans la lignée prophétique.
Or cette tradition ne sépare jamais la foi de la justice sociale.
Isaïe ne reproche pas l’absence de culte, mais un culte devenu compatible avec l’oppression :
‘Apprenez à faire le bien, recherchez le droit, redressez l’oppresseur’.
Isaïe 1, 17
Amos va plus loin encore. Il ne corrige pas le culte, il le rejette :
‘Je hais, je méprise vos fêtes… que le droit jaillisse comme les eaux’.
Amos 5, 21–24
La violence du verbe est essentielle.
Dieu ne tolère pas une religion qui sert de couverture morale à l’injustice sociale.
Michée condense cette tradition en une formule d’une sécheresse radicale :
‘Faire le droit, aimer la bonté, marcher humblement avec ton Elohîms’.
Michée 6, 8
Jésus s’inscrit exactement dans cette ligne.
Lorsqu’il proclame les Béatitudes, notamment chez Luc, il ne spiritualise rien :
‘En marche, les pauvres’… mais aussi ‘hélas pour vous, les riches’.
Luc 6, 20–26
Il ne console pas. Il désigne.
Il ne promet pas l’équilibre, mais le renversement.
Le Royaume qu’il annonce n’est pas un supplément d’âme ajouté à l’ordre existant.
C’est une mise en crise de cet ordre.
Les pauvres y sont centraux non par compassion, mais parce qu’ils révèlent l’injustice structurelle du monde.
Dire que Jésus est ‘de gauche’ est évidemment un anachronisme.
Le vocabulaire, les clivages, les institutions politiques modernes n’existent pas encore.
Mais l’anachronisme n’est pas une faute lorsqu’il est assumé comme outil de lecture.
Être de gauche, au sens politique contemporain minimal, signifie refuser que l’ordre social existant soit tenu pour légitime lorsqu’il produit pauvreté, domination et exclusion.
Cela signifie placer les plus vulnérables au centre de l’analyse, non par paternalisme, mais parce qu’ils révèlent la violence réelle des structures.
À ce titre, le message de Jésus est sans ambiguïté. Il part des pauvres, parle depuis eux, et juge le monde à partir de leur situation.
Si l’on accepte ce cadre, alors oui : Jésus est de gauche.
Radicalement.
2. Argent, pouvoir, Temple : le point de rupture
La question de l’argent n’est pas, chez Jésus, un thème moral parmi d’autres. Elle est structurante.
Elle touche à la souveraineté.
‘Vous ne pouvez servir Elohîms et la richesse’.
Matthieu 6, 24 ; Luc 16, 13
Le verbe ‘servir’ est ici décisif.
Il ne renvoie pas à une préférence intérieure, mais à une allégeance.
On sert un maître.
On obéit.
On s’inscrit dans un ordre.
La richesse n’est donc pas condamnée comme faute individuelle, mais comme puissance concurrente.
Elle produit un monde, une hiérarchie, une manière de voir et de ne pas voir.
Lorsqu’il affirme qu’il est difficile, voire impossible, pour un riche d’entrer dans le Royaume (Marc 10, 23–25), Jésus ne moralise pas. Il décrit un état social.
Le riche est celui que sa position protège de la dépendance, de la vulnérabilité, du besoin d’autrui.
Or le Royaume qu’il annonce repose précisément sur cette interdépendance assumée.
Ce positionnement n’est pas seulement moral, il est politique.
Jésus ne critique pas les riches parce qu’ils seraient personnellement mauvais, mais parce que leur position sociale les place objectivement du côté de la conservation de l’ordre.
Or l’ordre qu’il observe est un ordre qui produit des pauvres, puis les rend invisibles.
C’est en cela que sa parole est structurellement incompatible avec toute idéologie de droite, comprise comme défense de la hiérarchie, de la propriété sacralisée et de la stabilité sociale comme valeur suprême.
La parabole du riche et du pauvre Lazare pousse cette logique à son terme (Luc 16, 19–31).
Le riche n’est accusé ni de violence ni de cruauté.
Il vit normalement. Il mange bien. Il ignore.
Et c’est cette ignorance socialement permise qui le condamne.
Le texte ne reproche pas une action, mais une structure de regard.
Le Temple, dans ce contexte, n’est pas un simple lieu de prière.
C’est un centre économique, un nœud de pouvoir, un appareil religieux intégré à l’ordre social.
Le commerce qui s’y déploie n’est pas une dérive marginale. Il est le symptôme d’une religion devenue système.
Le Temple de Jérusalem n’est pas seulement un lieu de prière.
Il constitue un centre économique majeur, un espace de redistribution, un point de collecte et de circulation de l’argent, étroitement lié à l’aristocratie sacerdotale et, indirectement, à l’ordre romain.
Y toucher, ce n’est pas corriger une dérive morale, mais contester un dispositif de pouvoir où le religieux, l’économique et le politique sont indissociables.
La scène qui suit ne relève donc ni de l’emportement ni du symbole abstrait, mais d’un affrontement frontal avec une structure.
Lorsque Jésus entre dans le Temple, il ne débat pas.
Il agit. Jean insiste sur un détail que l’on préfère souvent minimiser :
‘Il fit un fouet de cordes et les chassa tous du Temple’.
Jean 2, 15
Le fouet n’est ni une métaphore ni une anecdote narrative.
C’est un geste théologico-politique. Une attaque frontale contre l’alliance du sacré et de l’argent.
Ce geste se retrouve, sous des formes convergentes, chez les synoptiques (Matthieu 21, 12–13 ; Marc 11, 15–17 ; Luc 19, 45–46).
Sa récurrence dit son importance. Jésus ne critique pas un abus.
Il vise une structure.
3. La joue gauche : dignité contre soumission
Peu de passages ont été aussi systématiquement neutralisés que celui de la joue tendue :
‘Si quelqu’un te frappe sur la joue droite, tends-lui l’autre’.
Matthieu 5, 39
Dans le contexte social antique, frapper du revers de la main était un geste réservé aux esclaves et aux inférieurs.
La main droite, elle, servait à frapper un égal.
Ce code est connu, partagé, immédiatement lisible pour les auditeurs de Jésus.
Tendre l’autre joue ne signifie donc pas accepter la violence.
Cela signifie refuser l’humiliation.
Jésus ne dit pas ‘frappe encore’. Il dit ‘frappe-moi comme un homme’.
Il contraint l’agresseur à reconnaître une égalité qu’il voulait nier.
Les auditeurs de Jésus connaissent parfaitement les codes sociaux de leur temps.
Les gestes, les postures et les coups portent un sens immédiatement lisible, inscrit dans une hiérarchie sociale intériorisée par tous.
C’est à partir de cette grammaire de l’humiliation et de la domination que la parole de Jésus doit être entendue.
Ce texte n’est pas un appel à la passivité.
C’est une stratégie de résistance non violente, mais profondément conflictuelle. Une manière de retourner la violence symbolique contre celui qui l’exerce.
Un texte de dignité, pas de soumission.
Ce déplacement de la dignité individuelle vers une conflictualité plus radicale trouve son expression la plus nette dans l’Évangile de Jean.
4. Jean, ou la radicalité sans compromis
Les Évangiles synoptiques donnent à voir la conflictualité sociale et politique du message de Jésus.
L’Évangile de Jean en déploie la portée la plus radicale.
Ici, la confrontation ne se joue plus seulement dans les structures visibles du pouvoir, mais dans la mise en crise du monde lui-même, compris comme un ordre organisé contre la vérité.
Impossible de comprendre la portée politique du message évangélique sans Jean.
Jean ne cherche pas le consensus.
Il tranche.
Dès l’ouverture, le cadre est posé :
‘La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas saisie’.
Jean 1, 5
Chez Jean, la lumière ne caresse pas.
Elle révèle.
Elle expose.
Elle met en crise.
Le monde, précise-t-il, hait cette lumière parce qu’elle dévoile ses œuvres (Jean 3, 19–21).
Jésus le dit lui-même sans détour :
‘Le monde me hait, car je témoigne contre lui que ses œuvres sont mauvaises’.
Jean 7, 7
Il n’y a ici aucune place pour une spiritualité consensuelle.
On ne négocie pas avec l’injustice. On ne dialogue pas avec le mensonge.
La neutralité devient déjà une prise de parti.
C’est ce qui rend Jean politiquement infréquentable pour toute droite attachée à l’ordre, à la hiérarchie et à la propriété tranquille.
Jean écrit pour des temps de conflit, pas pour des dîners œcuméniques.
Il n’y a pas, dans les Évangiles, de théologie de l’ordre.
Il n’y a pas de célébration de la stabilité sociale, ni de valorisation de la hiérarchie comme telle.
L’ordre n’est jamais présenté comme bon en soi, mais toujours comme suspect dès lors qu’il protège les puissants et écrase les faibles.
Cette suspicion radicale à l’égard de l’ordre est l’un des marqueurs les plus constants de la pensée politique de gauche.
Jean ne la tempère pas. Il la rend explosive.
5. Amour, mais amour exigeant
L’amour évangélique n’est pas présenté comme un sentiment, ni comme une disposition intérieure apaisante.
Il se manifeste dans des choix concrets, des fidélités coûteuses et des ruptures assumées avec ce qui produit l’injustice.
‘Tu aimeras IHVH ton Elohîms… et ton prochain comme toi-même’.
Matthieu 22, 37–40
Mais cet amour est immédiatement lié à l’action, à la fidélité concrète, à la justice.
Jean est explicite :
‘Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés’.
Jean 13, 34
Or cet amour passe par la rupture, par le refus de l’ordre injuste, par l’acceptation du conflit.
Jésus le dit sans détour :
‘Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l’épée’.
Matthieu 10, 34
Non la violence gratuite, mais la division qu’entraîne la vérité.
Une religion d’amour qui produit domination, massacres et accumulation obscène est une religion trahie.
Et cette trahison commence toujours par une pacification factice du message.
Si Jésus est de gauche au sens où son message attaque frontalement l’ordre injuste, alors une question devient inévitable : comment ce message a-t-il pu être récupéré, neutralisé, puis retourné pour justifier la domination, la propriété sacrée, l’ordre moral et l’obéissance ?
Conclusion de la Partie I
Que ferait Jésus à ma place ?
Question redoutable, tant elle est devenue un slogan creux.
Ma réponse, en tant que lecteur attentif des textes et citoyen vaguement cohérent, est d’une simplicité biblique : fouetter un banquier est presque toujours une bonne idée.
Ce n’est pas un programme politique.
C’est un rappel symbolique.
Ce n’est pas un appel à la violence.
C’est un test de cohérence.
Lorsque l’argent devient sacré, lorsque les temples se transforment en marchés, lorsque l’ordre protège l’injustice, alors la colère n’est pas un péché.
Elle est une fidélité.
De Jésus à l’ordre moral
Comment les Églises ont déplacé le centre de gravité du message
La réponse n’est pas à chercher dans les textes, mais dans leur usage.
C’est ce glissement, de la parole subversive à la religion d’ordre, que la seconde partie mettra au jour.
Préambule
À partir du moment où un message survit à celui qui le porte, il cesse d’être seulement une parole.
Il devient un enjeu.
Un capital symbolique.
Un objet de pouvoir.
La sociologie des religions, de Max Weber à Pierre Bourdieu, l’a montré avec constance : une religion ne se stabilise qu’au prix d’une transformation de son message initial.
Ce qui était rupture devient doctrine.
Ce qui était conflit devient norme.
Ce qui mettait le monde en accusation finit par l’organiser.
Le christianisme n’échappe pas à cette logique.
Il l’illustre avec une efficacité redoutable.
1. Quand une parole survit, elle devient un enjeu de pouvoir
Une parole vivante est instable.
Une parole transmise devient dangereuse.
Dès lors qu’un message excède la durée de vie de celui qui l’a porté, il cesse d’être seulement une expérience spirituelle. Il devient un objet à gérer, à transmettre, à fixer. Autrement dit : à contrôler.
La sociologie des religions l’a montré depuis longtemps. Toute religion instituée est le produit d’un compromis entre une parole initialement subversive et les nécessités de sa survie sociale.
Max Weber parlait déjà de la ‘routinisation du charisme’ : ce qui surgit comme rupture doit, pour durer, se transformer en règle, en fonction, en hiérarchie.
Ce mécanisme n’a rien d’accidentel.
Il relève de cette fatalité sociale qui transforme les ruptures en règles et les colères en institutions.
Il ne relève ni de la trahison morale, ni d’un complot.
Il relève de la structure.
Un message qui conteste l’ordre social ne peut devenir majoritaire qu’en cessant de le contester frontalement. Il doit se rendre compatible avec l’existant.
Il doit rassurer. Il doit promettre la paix là où il annonçait le conflit.
Le christianisme n’échappe pas à cette logique.
Il en est même un cas d’école.
La droite contemporaine n’a pas inventé ce retournement.
Elle l’a compris. Puis elle l’a exploité.
Car toute pensée réellement subversive devient, à terme, un danger pour ceux qui vivent de l’ordre établi. La droite, par définition, ne peut tolérer une parole qui conteste la propriété, l’accumulation, la hiérarchie et la transmission patrimoniale.
Elle a donc besoin d’un Jésus vidé de sa charge politique.
Ce Jésus-là est doux, patient, moral.
Il console, mais ne redistribue pas.
Il pardonne, mais ne renverse rien.
Il parle d’âme, jamais de structures.
Ce n’est pas une erreur d’interprétation.
C’est une opération politique.
Transformer une parole de renversement en éthique individuelle est le geste fondateur de toutes les droites religieuses.
On ne supprime pas le message, on le déplace.
On ne le réfute pas, on le neutralise.
La justice devient charité.
Le conflit devient faute morale.
La colère devient péché.
À partir de là, tout devient possible.
Même faire de Jésus le garant symbolique d’un ordre qu’il n’a cessé de combattre.
2. Institution, hiérarchie, obéissance : la fabrication d’une religion d’ordre
Là où Jésus parle en prophète itinérant, l’Église parle en institution.
Là où la parole évangélique met en accusation les puissants, l’appareil ecclésial apprend à composer avec eux.
Très tôt, le christianisme s’est structuré autour de trois piliers qui n’ont rien d’évangélique en eux-mêmes :
- une hiérarchie stable,
- un corpus doctrinal figé,
- une alliance avec le pouvoir politique.
Ce basculement n’est pas accidentel.
Il est stratégique.
Une Église sans hiérarchie ne gouverne rien.
Une Église sans dogme ne contrôle rien.
Une Église sans pouvoir matériel ne dure pas.
À partir de Constantin, le message chrétien cesse d’être un ferment de subversion sociale pour devenir un outil de cohésion impériale.
L’Empire n’est plus mis en accusation. Il est sacralisé.
L’obéissance devient vertu. L’ordre devient voulu par Dieu.
La figure de Jésus s’en trouve lentement reconfigurée.
On gomme le conflit.
On estompe la colère.
On sacralise la patience.
La croix, instrument d’exécution politique, devient symbole de résignation rédemptrice.
Ce qui était scandale devient décor.
Personnellement, je doute que Jésus ait trouvé très spirituel que l’on résume sa vie, sa parole et son conflit avec l’ordre établi à la croix, c’est-à-dire à l’outil administratif de sa mise à mort.
Le choix de ce symbole n’a rien d’innocent.
Il dit moins la résurrection que la domestication du scandale.
On n’a pas retenu le geste qui renverse, mais le supplice qui fait taire.
On n’a pas transmis la parole qui dérange, mais l’instrument qui rappelle ce qu’il en coûte de défier l’ordre.
3. La morale ne vient pas de la religion
C’est un point essentiel, et trop souvent passé sous silence.
La religion n’a pas inventé la morale.
Elle l’a, au mieux, formulée.
L’anthropologie, comme l’histoire des sociétés humaines, le montre sans ambiguïté : des systèmes moraux existent bien avant l’apparition des religions organisées.
Interdits du meurtre au sein du groupe, règles de réciprocité, limitation de la vengeance, protection des plus vulnérables.
Tout cela précède largement les monothéismes, et parfois même toute forme de sacralisation structurée.
La morale naît d’un fait brut et prosaïque : les humains doivent cohabiter sans s’anéantir.
Le fameux ‘œil pour œil, dent pour dent’ en est une illustration parfaite.
Contrairement à ce que l’on répète paresseusement, il ne s’agit pas d’un appel à la violence, mais d’une limitation de la violence.
Dans des sociétés où la vengeance collective pouvait conduire à l’extermination d’un clan ou d’un village entier, ce principe introduit une proportionnalité.
Il civilise la riposte.
Il empêche l’escalade.
Ce n’est pas une morale sublime.
C’est une morale fonctionnelle.
Et c’est précisément ce qui la rend décisive.
La morale est donc d’abord une construction humaine, sociale, pragmatique.
Elle naît du besoin de vivre ensemble sans sombrer dans la guerre permanente.
Elle est antérieure à toute révélation, à toute Église, à toute théologie.
La religion arrive après.
Elle sacralise ces règles.
Elle leur donne une autorité transcendante.
Parfois, elle les affine.
Parfois, elle les rigidifie.
Parfois, elle les détourne.
Elle peut être un vecteur de transmission, mais elle n’est jamais l’origine.
C’est précisément ce que montre, à sa manière, Immanuel Kant. Lorsqu’il fonde la morale sur la raison pratique, sur l’autonomie du sujet et sur l’universalité du devoir, il retire explicitement à la religion le monopole du bien et du mal.
La morale n’a pas besoin de Dieu pour obliger.
Elle s’impose parce qu’elle est rationnelle, partageable, cohérente.
À l’opposé, Friedrich Nietzsche démonte avec férocité la récupération religieuse de la morale.
Il montre comment le christianisme institutionnel a transformé une éthique vivante en morale de soumission, comment il a sacralisé la faiblesse, culpabilisé la force et travesti le conflit en faute.
Nietzsche ne nie pas la morale.
Il conteste son captage par une religion devenue outil de domination.
Les deux, pourtant, s’accordent sur un point fondamental : la morale ne descend pas du ciel.
Elle émerge des humains.
Lorsqu’une religion prétend être la source exclusive de la morale, elle ne fait pas que réécrire l’histoire à son avantage. Elle s’arroge un pouvoir exorbitant : celui de définir le bien et le mal au nom de Dieu, et donc de disqualifier toute contestation comme impie.
C’est à partir de là que la foi cesse d’être une quête, et devient un instrument.
Et c’est toujours à cet endroit précis que la politique s’invite.
4. Quand la religion devient identité politique
Le basculement décisif ne se produit pas lorsque la foi se structure, mais lorsqu’elle cesse d’être une expérience pour devenir une identité.
À partir du moment où l’appartenance religieuse définit le ‘nous’ et le ‘eux’, la croyance quitte le champ du spirituel pour entrer pleinement dans celui du politique.
Elle ne dit plus seulement ce que l’on croit, mais qui l’on est, et surtout qui ne l’est pas.
Ce déplacement est lourd de conséquences.
Une foi vécue peut cohabiter avec le doute, la contradiction, l’ambivalence.
Une foi identitaire, elle, exige la clarté, la frontière, la loyauté.
À cet instant précis, la religion devient un marqueur d’appartenance.
Elle ordonne le monde en groupes distincts, hiérarchisés, parfois incompatibles.
La vérité n’est plus cherchée, elle est possédée. Et ce qui est possédé doit être défendu.
C’est là que la violence devient possible, puis pensable, puis légitime.
Les guerres de religion européennes ne sont pas des accidents regrettables survenus dans des sociétés autrement pacifiées.
Elles constituent l’expression logique d’un sacré devenu frontière politique.
Catholiques et protestants ne s’y affrontent pas pour des subtilités théologiques, mais pour le contrôle des territoires, des institutions, des corps.
La Saint-Barthélemy n’est pas une “folie collective”.
C’est une opération politique menée au nom d’une vérité rendue absolue.
La foi y sert de langage, non de cause.
Elle fournit les mots, les justifications, les absolutions.
On ne massacre pas malgré l’amour prêché.
On massacre parce que cet amour a été redéfini comme exclusif.
Ce mécanisme ne relève ni d’une époque particulière ni d’une religion spécifique.
Il traverse les cultures, les siècles et les continents.
Là où une croyance devient indiscutable, là où le doute est assimilé à la trahison, là où l’altérité est perçue comme une menace, la violence se sacralise.
Les attentats djihadistes contemporains relèvent exactement de cette logique.
Ils ne sont pas l’expression de l’islam vécu, pas plus que l’Inquisition ne fut l’expression du christianisme vécu.
Dans les deux cas, il s’agit d’une fusion entre religion, identité et projet politique.
Refuser l’amalgame ne consiste pas à minimiser les crimes.
Il consiste à les comprendre correctement.
Le fanatique n’est pas un croyant excessif.
Il est un croyant déchargé de toute responsabilité morale personnelle, qui obéit à une vérité supposée supérieure.
Or une foi qui exige l’obéissance absolue cesse d’être une quête spirituelle.
Elle devient un instrument de pouvoir.
Et c’est toujours à cet endroit précis que la religion, quittant le domaine du sens, entre définitivement dans celui de la domination.
5. De l’Église à l’ordre social : la grande normalisation
Une fois la religion installée comme identité politique, une seconde transformation s’opère : la normalisation.
Ce qui relevait de la rupture a été figé en doctrine.
Le conflit a été converti en ordre, la subversion en tradition.
La justice collective s’est réduite à la charité individuelle.
La colère est devenue péché, et toute critique de l’ordre, une tentation à réprimer.
À partir de là, la religion ne dérange plus le pouvoir.
Elle le sert.
Elle bénit les armées, sanctifie les frontières, justifie les hiérarchies sociales, naturalise les inégalités.
Elle parle d’amour, mais exige l’obéissance.
Elle promet le salut, mais demande la patience.
Ce n’est pas une trahison ponctuelle.
C’est une transformation systémique.
À ce stade, le déplacement est accompli.
La parole de rupture est devenue langage de l’ordre.
Il reste désormais à comprendre comment cette transformation a fourni à la droite contemporaine l’un de ses outils symboliques les plus efficaces.
6. Jésus rendu compatible
C’est dans ce cadre qu’apparaît la figure la plus aboutie de cette domestication : le Jésus compatible.
Un Jésus moral, mais vidé de sa conflictualité.
Un Jésus compatissant, mais soigneusement désarmé.
Un Jésus exigeant pour les individus, mais indulgent pour les structures.
Ce Jésus-là ne renverse plus les tables.
Il apaise les consciences.
Il ne parle plus de l’argent comme d’un faux dieu, mais comme d’un risque personnel, presque psychologique.
Il ne met plus en cause les puissants, il invite les pauvres à la patience.
Il ne conteste plus l’ordre, il l’accompagne en lui donnant bonne conscience.
La transformation est décisive.
La parole de rupture est devenue éthique privée.
La justice sociale a été rabattue sur la charité.
Le conflit a été requalifié en faute morale.
Ce Jésus-là ne dérange plus personne.
Il est compatible avec le marché, avec la propriété, avec les hiérarchies existantes.
Il peut être invoqué sans danger, mobilisé sans risque, brandi sans conséquence.
Ce n’est pas un malentendu théologique.
C’est une nécessité politique.
Un Jésus fidèle au texte serait insupportable à un ordre fondé sur l’accumulation, la transmission patrimoniale et la sacralisation de l’inégalité.
Il fallait donc le transformer.
Le blanchir.
L’adoucir.
Le rendre fréquentable.
C’est ainsi qu’une parole de renversement devient une caution morale.
Et qu’un scandale vivant se mue en icône inoffensive.
7. Ce que la droite fait de Jésus
La droite contemporaine n’a pas inventé cette figure.
Elle en hérite.
Mais elle la perfectionne.
Dans cette version droitière du christianisme, Jésus ne s’attaque plus aux riches. Il célèbre les méritants.
Il ne met plus en cause les puissants. Il moralise les pauvres.
Il ne conteste plus l’ordre social. Il le sacralise.
Ce Jésus-là vote pour le marché, défend la propriété, soupçonne la solidarité et prêche la responsabilité individuelle. Il ne fouette plus les banquiers. Il bénit les entrepreneurs.
Dans sa version aboutie, Jésus n’est plus une parole de rupture, mais une caution morale.
Il ne parle plus depuis les marges, il rassure le centre.
Il n’interroge plus les structures, il corrige les comportements.
La pauvreté devient une faute personnelle.
La richesse, un signe de vertu.
L’injustice, un accident regrettable, jamais un système.
Dans cette version droitière du christianisme, Jésus ne renverse plus les tables. Il appelle à la patience.
Il ne dénonce plus les idoles. Il parle d’effort individuel.
Il ne trouble plus l’ordre. Il l’accompagne.
Ce retournement n’est pas une erreur théologique.
C’est une opération politique.
Il permet de conserver le prestige symbolique du christianisme tout en annulant sa charge subversive. Le message demeure, en apparence intact, mais vidé de sa direction. On garde les mots. On efface leur force.
La justice devient charité.
La colère devient péché.
La contestation devient manque d’amour.
Ainsi neutralisé, Jésus peut être mobilisé pour défendre exactement ce qu’il dénonçait : la sacralisation de la propriété, l’ordre social hiérarchisé, la transmission patrimoniale, l’obéissance comme vertu.
Ce n’est plus un prophète.
C’est un garant.
C’est dans ce cadre que se déploie, sans rupture visible, la figure du ‘Jésus néolibéral’. Un Jésus compatible avec le marché, l’inégalité et la domination, à condition qu’elles soient présentées comme naturelles, méritées ou voulues par Dieu.
La droite ne trahit pas Jésus par ignorance.
Elle le transforme par nécessité.
Un Jésus fidèle aux textes serait politiquement ingérable pour toute idéologie fondée sur l’ordre, la hiérarchie et la propriété tranquille.
Il faut donc l’adoucir, le blanchir, le rendre fréquentable.
On ne supprime pas la parole.
On la désarme.
C’est cette figure que l’on retrouve, sous des formes diverses, du ‘Jésus néolibéral’ européen au ‘Republican Jesus’ américain : un Jésus rendu compatible avec le marché, l’inégalité et la domination, pourvu qu’elles soient présentées comme naturelles, méritées ou voulues par Dieu.
8. Femmes, corps, filiation : la grande mise sous tutelle
Il est impossible de comprendre la transformation des religions en religions d’ordre sans regarder ce qu’elles ont fait des femmes.
Les religions n’ont pas inventé la domination masculine.
Mais elles l’ont sanctifiée, rationalisée et pérennisée.
Dans la quasi-totalité des sociétés humaines, la question de la filiation a été une obsession politique.
On est toujours certain de qui est la mère.
Le père, lui, est par nature putatif.
Cette asymétrie biologique a produit une angoisse sociale majeure : celle de la transmission.
La réponse fut presque partout la même : contrôler les femmes.
Les enfermer dans l’espace domestique.
Surveiller leur sexualité.
Faire de leur corps un territoire sous administration masculine.
La religion arrive ici comme un formidable accélérateur.
Elle transforme une angoisse sociale en ordre moral, puis en ordre divin.
Ce qui relevait d’un rapport de force devient une loi sacrée.
Ce qui était domination devient ‘nature’.
Les femmes ne sont plus des sujets moraux à part entière.
Elles deviennent des matrices, des épouses, des tentations, des dangers à contenir.
Leur parole est suspecte. Leur désir est coupable. Leur autonomie est une menace.
Ce n’est pas un hasard si les grandes religions institutionnelles ont produit des systèmes où la femme est soit idéalisée comme mère, soit diabolisée comme séductrice.
Dans les deux cas, elle n’est jamais pleinement libre.
Et ce schéma n’est pas un vestige archaïque.
Il structure encore aujourd’hui les discours et les politiques des droites religieuses, obsédées par le contrôle des corps féminins : avortement, contraception, place publique, rôle familial.
Sous des mots différents, c’est toujours la même peur qui s’exprime : perdre le contrôle de la filiation et de l’ordre social.
9. L’hétérosexualité obligatoire comme pilier de l’ordre religieux
Ce que la religion a fait aux femmes, elle l’a prolongé contre toutes les sexualités qui échappaient à la reproduction contrôlée.
L’homosexualité, puis plus largement les identités LGBT+, ont été perçues comme une double menace.
Une menace morale, parce qu’elles déstabilisent les ‘normes’.
Une menace politique, parce qu’elles rendent visible le caractère construit de l’ordre sexuel.
Une sexualité qui ne produit pas d’enfants échappe au système.
Une identité de genre non conforme révèle que le ‘naturel’ est une fiction sociale.
Une famille non hétérosexuelle montre que la transmission n’a rien d’évident.
Les religions institutionnelles ont répondu par la négation de l’humanité même de ces personnes.
On les a qualifiées d’anormales, de malades, de pécheresses.
On a prétendu les ‘soigner’. On a tenté de les ‘corriger’.
Et, trop souvent, on les a tuées.
Là encore, il ne s’agit pas d’un excès marginal, mais d’un mécanisme structurel.
Toute religion d’ordre a besoin de normes sexuelles strictes.
Parce que la sexualité est l’un des lieux où l’ordre social se fissure le plus facilement.
Les droites contemporaines ont parfaitement compris cela.
Leur obsession pour la ‘famille traditionnelle’, leur haine des personnes trans, leur acharnement contre les droits LGBT+ ne relèvent pas d’un conservatisme culturel anodin.
Il s’agit d’une bataille politique centrale pour maintenir un ordre hiérarchique, genré, reproductif.
10. Jésus et les marges : ce que l’on préfère oublier
Ce qui rend ce silence particulièrement obscène, c’est qu’il est en contradiction flagrante avec les textes eux-mêmes.
Jésus parle avec des femmes.
Il les écoute.
Il les place au centre de récits fondateurs.
Il se tient aux côtés de celles et ceux que l’ordre moral exclut : prostituées, adultères, corps impurs, vies disqualifiées.
Non pour les ‘ramener dans le rang’, mais pour désamorcer le pouvoir de la norme.
Ce n’est pas une sensibilité moderne plaquée sur les textes.
C’est une donnée textuelle que l’institution a soigneusement minimisée, puis effacée.
Un Jésus fidèle à ces gestes-là serait aujourd’hui du côté des femmes qui refusent la tutelle, des personnes LGBT+ qui exigent l’égalité, de toutes celles et ceux dont l’existence même dérange l’ordre moral.
Et c’est précisément pour cela qu’il a fallu le rendre compatible.
Conclusion : de la trahison à la récupération
Ce que révèle ce parcours, ce n’est pas une dérive accidentelle, mais une transformation méthodique.
La parole évangélique, dans ce qu’elle a de plus radical, ne pouvait survivre intacte à son installation dans le monde social.
Trop de conflictualité. Trop de mise en cause de l’argent, du pouvoir, de la hiérarchie.
Trop peu de garanties pour ceux qui vivent de l’ordre établi.
Il a donc fallu choisir.
Non pas entre la foi et la politique, mais entre la subversion et la stabilité.
Et ce choix fut fait très tôt.
L’institution a préféré la paix sociale à la vérité conflictuelle, l’obéissance à la justice, la morale individuelle à la transformation collective.
À partir de là, le mouvement était irréversible.
La religion est devenue un langage du pouvoir.
La foi, une identité.
L’amour, une injonction à la patience.
La droite, elle, n’a fait que pousser jusqu’à sa perfection logique ce travail de neutralisation.
En vidant Jésus de sa charge politique, elle a pu en faire une figure compatible avec le marché, la propriété et l’inégalité.
Un Jésus sans colère, sans fouet, sans renversement. Un Jésus utile.
Ce glissement, de la parole subversive à la religion d’ordre, n’est pas une trahison ponctuelle.
C’est une stratégie de survie des systèmes dominants.
Et c’est précisément ce que la suite de l’histoire continue de mettre en scène.
Conclusion générale
Jésus, ou le scandale qu’on préfère oublier
Relire les Évangiles sans les anesthésier conduit à une évidence inconfortable.
Jésus n’est ni un modéré, ni un centriste, ni un sage consensuel.
Il parle depuis les marges, pour les humiliés, contre les puissants.
Il s’attaque à l’argent comme à une idole, au Temple comme à une institution capturée, et à l’ordre comme à une construction injuste.
Si l’on accepte, par anachronisme assumé, de traduire cette position dans nos catégories politiques contemporaines, alors oui : Jésus est de gauche.
Non par étiquette, mais par orientation fondamentale.
Parce qu’il place les pauvres au centre.
Parce qu’il conteste l’accumulation.
Parce qu’il refuse de sacraliser l’ordre existant.
Parce qu’il préfère le conflit juste à la paix injuste.
Tout le reste est récupération.
Les Églises ont, pour une large part, choisi la continuité plutôt que la fidélité.
La droite a trouvé dans cette version pacifiée un allié précieux.
Et l’on a fini par produire un Jésus méconnaissable, moral mais inoffensif, spirituel mais politiquement muet.
Reste alors cette question, trop souvent vidée de sa substance : Que ferait Jésus à ma place ?
Posée sérieusement, elle cesse d’être un slogan édifiant pour redevenir ce qu’elle est : une question dangereuse.
Elle oblige à regarder où l’on se tient, qui l’on sert, ce que l’on sacralise.
Elle interdit le confort de la neutralité.
Elle rappelle que la fidélité n’est jamais tranquille.
Et c’est sans doute pour cela qu’on a passé tant de temps à l’oublier.
On dissèque ici des idées, des textes ou des figures pour en exposer les mécanismes, les ambiguïtés, les usages. Un scalpel dans la main gauche, la pensée critique dans la droite.
Parfois, je n’utilise cette série uniquement parce qu’il n’est toujours pas légal de pratiquer des autopsies sur des gens vivants et que ce vert fait super joli en bas d’un article. Mais dans l’ensemble, c’est l’explication ci-dessus qui s’applique.
Une réaction, un désaccord, une idée ?
Cliquez sur la bulle 💬 rose en bas à gauche pour laisser un commentaire.
Je lis tout. Je réponds toujours.
Envie de faire circuler cet article ?
Vous pouvez le partager via les icônes en haut ou en bas de cette page.
Envie de suivre les prochaines publications ?
→ S’abonner à la newsletter

Léon Chelli arpente les mondes de l’automobile et des énergies renouvelables à travers la transition écologique. Il y déchiffre mutations industrielles et stratégies de marché avec la lucidité un peu sauvage d’un promeneur qui choisit ses propres sentiers.
Il explore les transitions avec une vision systémique, entre ironie assumée et clarté analytique.