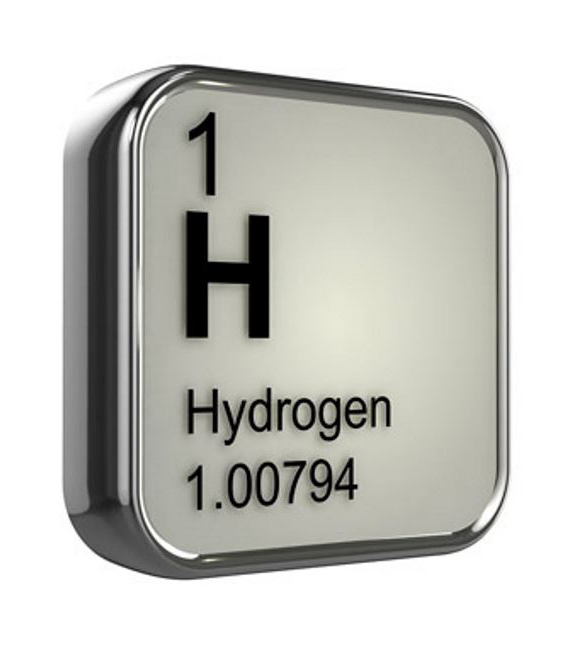Jane Goodall est morte
Avec elle disparaît bien plus qu’une figure médiatique : c’est une révolution scientifique, une manière d’observer et de comprendre le vivant qui s’éteint.
Son nom reste indissociable de Gombe, des chimpanzés et de cette idée simple mais bouleversante que l’animal n’est pas un objet mais un sujet, doté d’intelligence, d’émotions et d’histoire.
Elle a bousculé la biologie, éclairé l’anthropologie, ouvert l’éthologie à la longue durée, et montré que la science pouvait être un geste à la fois rigoureux et éthique.
À l’heure où l’on redessine les frontières entre humain et non-humain, son héritage pèse de tout son poids.
À revoir dans cette vidéo du Monde, un portrait condensé de Jane Goodall, sa carrière et son héritage scientifique :
Biographie scientifique : d’une passion solitaire à une révolution collective
Jane Goodall n’était pas biologiste au départ. Pas de diplôme en zoologie, ni en anthropologie.
Elle était simplement animée d’une obsession : comprendre les animaux autrement que dans les livres ou derrière des barreaux.
Ce goût de l’observation directe, elle le porta dès son enfance londonienne, carnet à la main, à l’affût des oiseaux et des chiens.
Sa rencontre avec Louis Leakey, le paléontologue kényan, fut décisive.
Là où l’université voyait une jeune femme sans cursus, lui discerna une alliée pour ses propres intuitions : les primates, voisins évolutifs de l’humain, pouvaient livrer des clés sur nos origines.
En 1960, il lui confia donc une mission insensée pour l’époque : s’installer dans la forêt de Gombe, en Tanzanie, seule, et observer les chimpanzés.
Elle commença avec des moyens dérisoires : jumelles, carnets, une tente de fortune.
Loin des laboratoires, elle inventa sa méthode : patience, immersion, observation continue.
Cette approche, qui semblait naïve aux yeux des universitaires, allait bouleverser la primatologie.
Cambridge finira pourtant par la rattraper : en 1965, Goodall soutient une thèse de doctorat sous la direction de Robert Hinde, sans même avoir une licence en poche.
Reconnaissance forcée d’un fait accompli : sa science de terrain avait déjà ouvert une brèche irréversible.
Ce qu’elle a apporté à l’éthologie et à la primatologie
L’œuvre de Jane Goodall n’est pas une simple chronique de terrain.
Elle a profondément déplacé les frontières de la connaissance scientifique, à plusieurs niveaux.
L’outil n’est plus le privilège de l’homme
En 1960, elle observe un chimpanzé, David Greybeard, sélectionner une brindille, l’effeuiller, puis l’utiliser pour extraire des termites.
Cette scène pulvérise un dogme : jusque-là, la fabrication d’outils définissait l’humanité.
Désormais, l’homme n’est plus « le seul animal qui fabrique des outils », formule que Louis Leakey reformule aussitôt :
« Il faut redéfinir l’homme, redéfinir l’outil, ou accepter les chimpanzés comme humains. »
David Leaky
Des individus, pas des numéros
Jane Goodall refuse de numéroter ses sujets d’étude.
Elle leur donne des noms : Flo, Fifi, Passion, Frodo… et décrit leurs caractères, leurs émotions, leurs histoires familiales.
Pour la première fois, des chimpanzés deviennent visibles comme des personnes animales, dotées de singularité.
Cette rupture méthodologique choque d’abord, puis s’impose comme une évidence.

Émotions, liens et structures sociales
Elle documente les attachements mère-enfant, les jeux, l’empathie, mais aussi la cruauté et la violence.
Les chimpanzés qu’elle observe ne sont pas des « bons sauvages » : ils forment des alliances politiques, se livrent à des guerres territoriales, connaissent jalousie et réconciliation.
L’éthologie entre alors dans une dimension politique, presque anthropologique.
Carnivores, chasseurs, partageurs
Contredisant l’image de primates frugivores, Goodall observe qu’ils chassent colobes et singes rouges, consomment de la viande et partagent leurs proies.
L’humain n’est donc pas seul à développer des pratiques carnées organisées.
Une science du temps long
L’un des héritages majeurs est méthodologique : l’observation longitudinale.
Ses notes couvrent plus de soixante ans, offrant une profondeur temporelle inédite sur le cycle de vie des chimpanzés, leurs évolutions, leurs dynamiques de groupe.
Là où d’autres multipliaient les expériences courtes en laboratoire, Jane Goodall a prouvé la valeur inestimable du terrain et de la durée.
Science et éthique liées
Enfin, Jane Goodall a brisé la frontière entre chercheuse et militante.
Observer les chimpanzés impliquait de protéger leur habitat, de travailler avec les communautés humaines locales, de relier la science à l’écologie et à la politique.
Cette articulation entre savoir et devoir est devenue une matrice pour des générations de chercheurs.
Répercussions dans l’anthropologie et les sciences humaines
Le travail de Jane Goodall a eu des effets bien au-delà de la zoologie.
Il a fissuré des certitudes sur ce qui définit l’humain, et nourri des champs entiers de réflexion.
La frontière humain/animal remise en cause
En montrant que les chimpanzés fabriquent des outils, ressentent des émotions, organisent des structures sociales complexes, Jane Goodall a contribué à réduire l’abîme supposé entre nous et eux.
L’humanité n’apparaît plus comme une rupture, mais comme un continuum évolutif.
Cette idée a reconfiguré l’anthropologie biologique et les sciences cognitives.
La cognition animale réhabilitée
Ses descriptions fines d’apprentissage, d’imitation, de transmission culturelle ont ouvert la voie à l’étude des cultures animales.
Oui, certains savoirs se transmettent d’un groupe à l’autre.
Oui, la mémoire, l’intentionnalité, l’apprentissage social existent hors de l’espèce humaine.
Un séisme intellectuel pour une époque encore dominée par le béhaviorisme.
L’éthique animale et la philosophie morale
Ses observations ont alimenté les débats contemporains sur les droits des animaux et la reconnaissance de leur subjectivité.
Les travaux de philosophes comme Peter Singer ou Martha Nussbaum trouvent chez Goodall une caution empirique : les animaux ne sont pas seulement capables de souffrir, ils sont aussi capables de relations et de projets.
Un modèle méthodologique pour les sciences sociales
Son immersion de terrain a inspiré l’anthropologie elle-même : observer longuement, en respectant les dynamiques locales, intégrer les contextes.
Là où d’autres disciplines cloisonnaient l’objet d’étude, Goodall a montré l’importance de la co-présence et de la durée.
Critiques, limites et débats
Un hommage scientifique ne vaut que s’il garde une lucidité critique.
L’œuvre de Jane Goodall, immense, n’a pas échappé aux débats.
L’influence de l’observatrice
Donner des noms aux chimpanzés, les habituer à sa présence : autant d’actes qui ont nourri la critique d’un biais d’observation.
Certains chercheurs ont estimé que ces familiarités transformaient le comportement des animaux, brouillant la ligne entre science et empathie.
Le nourrissage contesté
Dans les premières années à Gombe, pour faciliter l’approche, Goodall a distribué de la nourriture aux chimpanzés.
Cette pratique a été accusée d’avoir perturbé les équilibres sociaux et même favorisé la violence intra-groupe.
Elle-même reconnaîtra plus tard cette limite, en ajustant sa méthode.
L’“anecdotisme cognitif”
Certains collègues lui reprochent d’inférer trop vite des états mentaux à partir de comportements observés.
Attribuer des intentions, des émotions, une subjectivité : démarche jugée trop littéraire par les tenants d’une objectivité stricte.
Mais ce reproche s’est affaibli au fil des décennies, à mesure que les sciences cognitives validaient empiriquement une part de ses intuitions.
La généralisation fragile
Autre débat : les chimpanzés de Gombe ne sont pas tous les chimpanzés.
Les cultures, environnements et comportements diffèrent d’une population à l’autre.
Les généralisations hâtives ont parfois été contestées.
Science et militantisme
Enfin, une critique récurrente : son engagement écologique et politique aurait brouillé sa neutralité scientifique.
Mais cette tension est aussi sa marque : Goodall a assumé que la science ne se pratique pas hors du monde, et qu’observer implique aussi de protéger.
Héritage, postérité et leçons pour aujourd’hui
Jane Goodall n’a pas seulement bouleversé la primatologie.
Elle a transformé la manière d’habiter la science et d’en prolonger les conséquences.
Le Jane Goodall Institute
Fondé en 1977, il est devenu un acteur majeur de la conservation et de la recherche appliquée.
Ses projets s’étendent de la protection des forêts à la coopération avec les communautés locales. L’idée centrale : pas de préservation des chimpanzés sans prise en compte des humains qui partagent leur territoire.
Roots & Shoots : l’éducation comme prolongement
En 1991, elle crée Roots & Shoots, programme destiné à engager la jeunesse dans des actions locales. Jardins communautaires, initiatives de recyclage, préservation d’habitats : une pédagogie de l’action, pour relier savoir, responsabilité et avenir.
La figure de la scientifique engagée
Avec Goodall, la chercheuse cesse d’être une observatrice distante.
Elle devient une actrice du monde, portant sa voix à l’ONU, dans les médias, auprès des gouvernements. Elle aura incarné un modèle de “science en action”, loin du mythe du savant neutre et isolé.
Une matrice pour les jeunes générations
Son legs n’est pas seulement théorique : il est méthodologique et moral.
Observer patiemment, respecter l’objet étudié, ne pas séparer la connaissance de l’éthique.
Ce triptyque reste une boussole pour qui veut comprendre le vivant aujourd’hui.
Une trace dans l’imaginaire collectif
Enfin, son image elle-même (silhouette mince, regard clair, accent britannique doux mais déterminé) est devenue symbole de ténacité et de douceur lucide.
Comme Rachel Carson ou Stephen Jay Gould, Jane Goodall appartient désormais à la lignée des scientifiques dont l’héritage dépasse la discipline pour irriguer la culture.
Conclusion : l’élégance de la rigueur et du devoir
Jane Goodall a passé sa vie à regarder.
À noter, à décrire, à raconter.
Mais ce regard n’était pas celui d’une touriste émerveillée, ni celui d’un technicien froid : c’était un regard habité, où la patience se doublait d’un sens aigu du devoir.
Observer les chimpanzés, c’était aussi défendre leur monde, et rappeler que le nôtre ne vaut que par ce que nous en faisons.
Son héritage est scientifique, bien sûr : des décennies d’observations qui ont redessiné la frontière entre l’humain et l’animal.
Mais il est aussi éthique : elle a montré qu’il n’existe pas de science sans responsabilité, pas de savoir sans choix, pas de regard neutre sur le vivant.
Aujourd’hui, son absence laisse un vide immense. Mais ses carnets, ses instituts, ses disciples, et surtout sa leçon d’humanité dans la science, demeurent.
Elle a prouvé qu’observer, ressentir et agir pouvaient être un seul et même geste scientifique.

Une réaction, un désaccord, une idée ?
Cliquez sur la bulle 💬 rose en bas à gauche pour laisser un commentaire.
Je lis tout. Je réponds toujours.
Envie de faire circuler cet article ?
Vous pouvez le partager via les icônes en haut ou en bas de cette page.
Envie de suivre les prochaines publications ?
→ S’abonner à la newsletter

Léon Chelli arpente les mondes de l’automobile et des énergies renouvelables à travers la transition écologique. Il y déchiffre mutations industrielles et stratégies de marché avec la lucidité un peu sauvage d’un promeneur qui choisit ses propres sentiers.
Il explore les transitions avec une vision systémique, entre ironie assumée et clarté analytique.