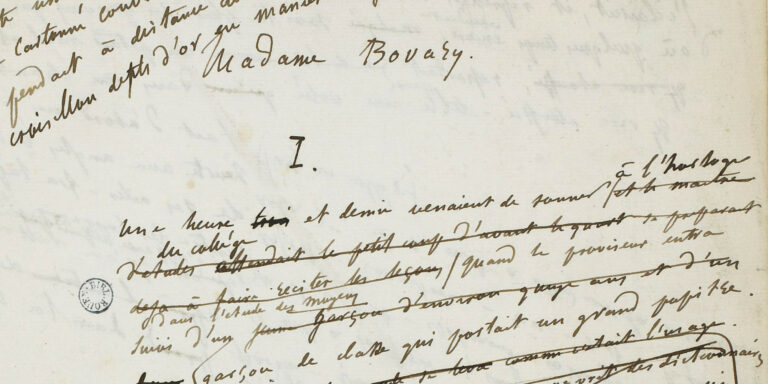Carbone bleu : une promesse sous surveillance
À l’île Maurice, des mangroves et des herbiers marins sont aujourd’hui mobilisés pour tester le stockage de CO₂ dans les sédiments côtiers. Ce qu’on appelle carbone bleu.

Sur le papier, ces écosystèmes sont des champions : ils captent plusieurs fois plus de CO₂ par hectare que les forêts terrestres, et le stockent dans leurs racines, leurs feuilles et surtout dans les sols marins.
Mieux : ces milieux rendent aussi d’autres services écologiques majeurs : protection du littoral, nurserie pour la biodiversité, filtration naturelle.
Mais derrière l’élan de l’UNOC (la grande conférence des Nations Unies pour les océans), plusieurs limites apparaissent :
- Robustesse scientifique incertaine :
Les dynamiques de séquestration varient fortement selon les sites, les perturbations, les espèces. Le stockage est souvent instable et difficile à mesurer. - Crédits carbone prématurés :
Alors même que la science tâtonne encore, certains projets ont déjà commencé à générer des crédits.
Le risque ? Financer une solution fragile sans garanties d’impact climatique réel. - Colonialité du climat :
Comme souvent, ce sont les pays du Sud qui fournissent les écosystèmes… pendant que les pays riches continuent à émettre.
Sans justice environnementale ni financement à long terme, le carbone bleu pourrait n’être qu’un nouveau greenwashing.
Une réaction, un désaccord, une idée ?
Cliquez sur la bulle 💬 rose en bas à gauche pour laisser un commentaire.
Je lis tout. Je réponds toujours.
Envie de faire circuler cet article ?
Vous pouvez le partager via les icônes en haut ou en bas de cette page.
Envie de suivre les prochaines publications ?
→ S’abonner à la newsletter

Léon Chelli arpente les mondes de l’automobile et des énergies renouvelables à l’épreuve de la transition écologique.
Il y déchiffre mutations industrielles et stratégies de marché avec la lucidité un peu sauvage d’un promeneur qui choisit ses propres sentiers.
Il explore les transitions avec une vision systémique, entre ironie assumée et clarté analytique.