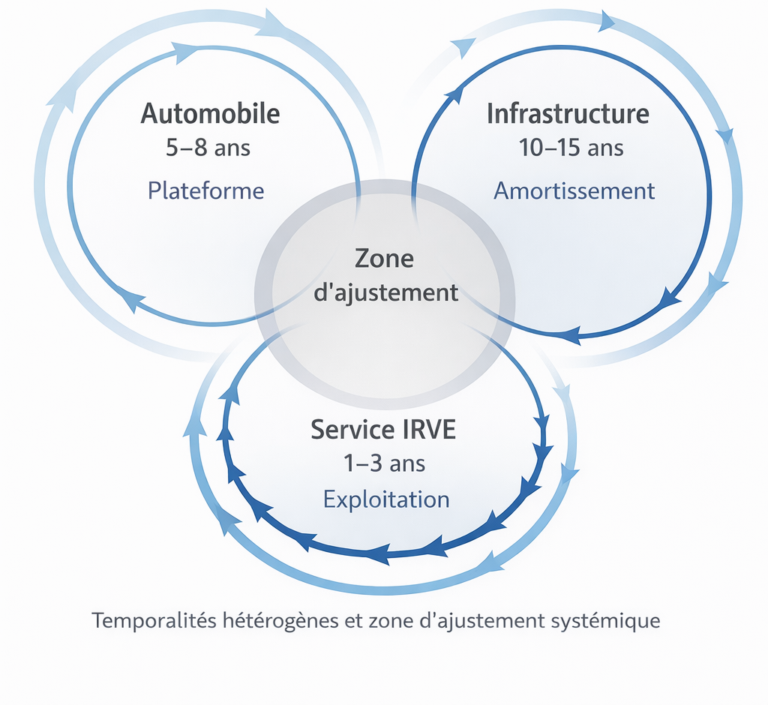Bilan écologistes Lyon : 5 ans d’action municipale & métropolitaine
Réduits à des caricatures par une partie de la presse locale, les écologistes lyonnais ont pourtant mis en œuvre des politiques ambitieuses. Bilan lucide d’un premier mandat entre réussites concrètes et critiques parfois intéressées.
Chiffres clés et investissements
Pour sortir des slogans et juger l’action sur pièces, rien ne vaut un regard sur les chiffres : investissements, dépenses, dettes, logements… Voici une synthèse chiffrée du bilan écologiste à Lyon et dans sa Métropole.
| Domaine | Chiffre / Indication | Contexte / Explication |
|---|---|---|
| Programmation pluriannuelle d’investissements (PPI) 2021‑2026 | 3,6 milliards d’euros | Plan voté par la Métropole pour engager la relance écologique et solidaire, incluant transports, végétalisation, logement, innovation, déchets. |
| Budget transition écologique 2025 | 472,7 millions d’euros | Mobilités douces, gestion de l’eau, assainissement, rénovation énergétique, plan canopée… |
| Investissement mobilité (2025) | 350,4 millions d’euros | Dont 163,3 M€ pour transports publics (Sytral), 60,2 M€ pour Voies Lyonnaises, etc. |
| Dépenses sociales | ≈ 838,6 millions d’euros | Soit 23,1 % du budget de fonctionnement de la Métropole (~2,5 milliards d’euros). |
| Logement social | ≈ 3 084 logements en 2022 | En augmentation par rapport à 2021 (2 526). Progression visible, même si les objectifs restent plus ambitieux. |
| Office foncier agricole | 2,5 millions d’euros | Créé pour préserver le foncier agricole de la Métropole et soutenir l’agriculture bio et de proximité. |
| Réduction de la dette | –250 millions d’euros | Dette métropolitaine réduite depuis 2020, tout en augmentant les investissements publics. |
Le tableau met en lumière une stratégie budgétaire à contre-courant des idées reçues : les écologistes n’ont pas désinvesti, ils ont massivement investi.
Mieux : ils l’ont fait tout en réduisant la dette, ce qui démontre une gestion rigoureuse et structurée, loin des caricatures d’amateurisme financier souvent brandies à leur encontre.
Analyse
Certains chiffres sont particulièrement significatifs :
- La PPI (Programmation Pluriannuelle d’Investissements) de 3,6 milliards d’euros sur six ans montre une volonté claire de transformation systémique.
- Les 472 millions d’euros consacrés à la transition écologique en 2025 placent Lyon dans le peloton de tête des métropoles françaises sur le sujet.
- La part sociale du budget (23 %) reste élevée, confirmant un cap de justice sociale assumé.
- Le logement social progresse, même si les ambitions restent en partie contrariées par la complexité du foncier urbain.
- Enfin, la réduction de 250 millions d’euros de dette est un marqueur politique fort, presque symbolique, dans un contexte de tensions budgétaires généralisées.
Autrement dit : des moyens, une méthode, un cap.
Les écologistes lyonnais montrent qu’on peut investir dans la transition sans creuser les déficits, et que l’écologie appliquée n’est pas une abstraction, mais une réorientation concrète de la dépense publique.
Actions sur le terrain
Loin des effets d’annonce, ce sont les transformations concrètes de l’espace public qui donnent sens à l’action écologiste : rues apaisées, végétalisation massive, mobilités durables… Sur le terrain, la transition est déjà visible et mesurable.
Les faits
Rues des enfants
Depuis 2020, des dizaines de rues aux abords d’établissements scolaires, maternelles, crèches ont été aménagées pour sécuriser et apaiser l’espace public.
À Lyon, 104 établissements sont désormais concernés, ce qui permet à plus de 7 500 élèves de bénéficier d’un environnement plus sûr et plus accueillant.

Plan Nature / végétalisation
La Métropole de Lyon a voté 44 millions d’euros en 2021 pour son Plan Nature.
En parallèle, la Ville de Lyon a lancé un vaste plan végétalisation doté de 141 millions d’euros pour ce mandat (2020–2026).
En 2023, Lyon a planté 3 126 arbres, végétalisé près de 9 hectares supplémentaires depuis 2020, et mis en place 50 actions dans différents arrondissements pour multiplier les espaces verts de proximité.
Zone à faibles émissions (ZFE‑métropolitaine)
La ZFE de la Métropole de Lyon est entrée en vigueur le 1er janvier 2020. Elle interdit la circulation ou le stationnement des véhicules les plus polluants (poids lourds, VUL classés Crit’Air 3, 4, 5 et non classés) sur le périmètre qui la définit. Cette mesure contribue à la réduction des émissions de NOx et particules fines, notamment dans les secteurs fortement urbanisés.
Réseau cyclable et mobilité douce :
- Extension du réseau « Voies Lyonnaises », sécurisation des abords, élargissement des trottoirs.
- Projets piétons devant écoles (rues sécurisées pour enfants) — partie du dispositif “Rues des enfants”.
- Actions complémentaires : autopartage, incitations à la mobilité partagée, adaptation de l’espace public pour les modes non motorisés.

L’analyse
Le bilan terrain des écologistes à Lyon et dans sa Métropole montre une dynamique significative, concrète, et visible au quotidien. Quelques enseignements :
- Proximité et impact palpable
Les “rues des enfants” ne sont pas des gadgets : ce sont des aménagements visibles près des écoles, des crèches — là où la sécurité, le bruit, la pollution importent le plus pour les familles. Toucher 7 500 élèves avec 104 établissements aménagés, c’est une assise réelle. - Montants importants investis
Le Plan Nature (44 M€) et le plan végétalisation de la Ville de Lyon (141 M€) sont lourds de sens : ils montrent que ces mesures ne sont pas accessoires, mais centrales. Planter plus de 3 000 arbres en une année, végétaliser des hectares, ce sont des investissements concrets dans le climat, la biodiversité et la qualité de vie. - Effets synergiques
La ZFE, la végétalisation, les rues apaisées jouent toutes en faveur d’une réduction des polluants atmosphériques, de la chaleur urbaine, du bruit. Ce ne sont pas des politiques isolées, mais qui se renforcent mutuellement. - Limites ou défis persistants
- Même si 9 hectares végétalisés depuis 2020 est un progrès, cela reste peu au regard de la densité urbaine, et l’objectif des “10 m² de nature de proximité par habitant” de l’OMS n’est pas encore atteint dans toutes les zones.
- Des disparités territoriales : certaines communes périphériques ou quartiers populaires sont encore moins bien servis en aménagements verts, en rues sécurisées, etc.
- Questions d’entretien, de suivi : planter des arbres c’est une chose, mais qu’ils grandissent, soient entretenus et intègrent la trame verte globale, c’est une autre.
Pollution, climat, santé publique
Les faits
Pollution de l’air
La qualité de l’air dans la Métropole de Lyon s’est nettement améliorée ces dernières années.
Selon Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, les concentrations en dioxyde d’azote (NO₂) ont baissé de 37 % autour du périphérique, et globalement de 22 % sur l’ensemble du territoire entre 2019 et 2024.
Les particules fines (PM10 et PM2,5) ont diminué de 11 % sur la même période.
Sur un temps plus long, la baisse atteint −50 % pour le NO₂, −49 % pour les PM10 et −64 % pour les PM2,5 depuis 2007.
Ces résultats sont le fruit de plusieurs politiques convergentes : mise en place de la Zone à Faibles Émissions (ZFE), réduction du trafic automobile, développement des transports en commun, extension des mobilités douces, aménagements favorables à la marche, et végétalisation progressive de l’espace urbain.
Émissions de gaz à effet de serre (GES)
La Métropole revendique une réduction de 24 % des émissions territoriales de GES entre 2019 et 2024, grâce à une politique volontariste : rénovation thermique des bâtiments, décarbonation industrielle, électrification de la flotte TCL, développement du vélo, végétalisation, etc.
Cette tendance est corroborée par les inventaires régionaux, qui estiment une baisse de 15 % entre 2015 et 2021.
L’écart s’explique par les périmètres d’analyse, les sources utilisées et les méthodes de calcul. Mais tous les indicateurs convergent : la trajectoire de réduction s’est fortement accélérée depuis l’arrivée de la majorité écologiste en 2020.
Santé publique
Les bénéfices sanitaires sont directs : moins de polluants, c’est moins de maladies respiratoires chroniques, d’asthme, de complications cardiaques, d’hospitalisations.
Les enfants et les personnes âgées sont les premiers bénéficiaires.
Selon une étude EQIS régionale, plusieurs milliers de décès annuels sont attribuables à la pollution de l’air dans la région Auvergne‑Rhône‑Alpes, ce qui montre l’enjeu vital des politiques engagées.
La végétalisation, en réduisant les îlots de chaleur, joue également un rôle majeur lors des épisodes caniculaires.
Elle contribue à améliorer le confort thermique urbain, à réduire le stress environnemental, et à rétablir une forme de justice territoriale dans l’accès à un cadre de vie sain.

L’analyse
Une amélioration tangible, documentée, indiscutable
Contrairement à certaines politiques qui peinent à prouver leur impact, les actions engagées à Lyon depuis 2020 affichent des résultats chiffrés incontestables.
Les baisses de polluants atmosphériques (NO₂, PM10, PM2,5) sont nettes, continues, mesurables, et dépassent souvent les moyennes nationales.
Cela démontre une chose simple : quand on agit, ça marche.
Et la Métropole agit.
Une stratégie convergente, pas une addition de mesures
Là encore, l’approche systémique fait la différence.
Les résultats ne viennent pas d’une mesure unique, mais de l’imbrication cohérente de plusieurs politiques publiques : ZFE, végétalisation, mobilité douce, aménagements urbains, rénovation énergétique…
Autrement dit : ce n’est pas un catalogue, c’est une trajectoire.
L’accélération depuis 2020, un fait politique
Les données régionales montrent un ralentissement dans les années 2015–2019, puis une nette accélération de la baisse des GES à partir de 2020.
C’est un point clé : le changement de majorité a produit un changement de rythme.
Ce n’est pas une simple continuité administrative.
C’est un changement politique assumé, visible dans les chiffres.
Santé publique : l’angle oublié… sauf à Lyon
Trop souvent, les politiques climat sont jugées abstraites ou lointaines.
À Lyon, elles ont un impact concret sur la santé des habitants, particulièrement des enfants et des personnes âgées.
En période de canicule, de crise hospitalière et de stress environnemental, ces bénéfices sont majeurs, durables, et profondément égalitaires.
Limites et défis : toujours les mêmes
La pollution n’a pas disparu. Certains quartiers restent plus exposés.
Le trafic ne s’est pas effondré. La justice environnementale réelle reste à parfaire.
Mais les bases sont là, solides.
Et surtout : l’impulsion politique est forte, méthodique, constante.
Logement
Les faits
La Métropole de Lyon compte aujourd’hui plus de 180 000 logements sociaux.
En 2024, elle a reçu environ 88 700 demandes de logement social, pour seulement 9 200 attributions.
En 2022, elle a financé près de 3 084 logements sociaux, en progression par rapport à l’année précédente (2 526).
L’objectif affiché est de porter ce chiffre à 5 000 logements financés par an d’ici 2026.
Le taux SRU (objectif légal de 25 % de logements sociaux) atteint désormais 27,2 %, en hausse de deux points depuis 2019.
Lyon Métropole Habitat, principal bailleur social, a livré 412 logements neufs en 2024 et en construit 460 supplémentaires, avec un investissement total de 146 millions d’euros pour l’année, dont près d’un tiers sur fonds propres.

L’analyse
Le déséquilibre entre offre et demande reste criant, malgré les efforts visibles.
Avec près de 10 demandes pour chaque attribution, le logement social demeure l’un des plus grands défis sociaux de la Métropole.
L’augmentation du taux SRU est un signal positif, qui témoigne d’une volonté politique réelle de rééquilibrage.
Lyon Métropole Habitat joue un rôle moteur, y compris dans un contexte économique défavorable.
L’objectif de 5 000 logements annuels reste ambitieux et difficile à tenir sans mobilisation conjointe des communes, du foncier et de l’État. Mais la trajectoire est engagée.
Culture
Les faits
Les données disponibles sur les politiques culturelles métropolitaines restent limitées.
Les documents budgétaires de la Ville et de la Métropole ne détaillent pas systématiquement les enveloppes culturelles, et les bilans récents ne comportent pas de volet spécifique.
Cependant, des indicateurs indirects existent : la Métropole soutient régulièrement des événements comme la Biennale d’art contemporain, les Nuits de Fourvière, la Fête des Lumières ou encore le festival Quais du polar.
En 2024, le territoire a enregistré plus de 9,5 millions de nuitées touristiques, en partie liées au rayonnement culturel.
L’analyse
La culture semble reléguée à l’arrière-plan des bilans politiques, ce qui affaiblit la lisibilité de l’action publique en la matière.
Pourtant, les dynamiques culturelles sont bien présentes, et souvent soutenues financièrement.
L’absence de chiffres consolidés empêche une évaluation sérieuse de l’action écologiste dans ce domaine.
Il serait pourtant crucial d’analyser les effets des politiques culturelles sur les territoires : soutien aux artistes, accès à la culture dans les quartiers populaires, maintien des lieux de création et de diffusion.
Sans cela, le risque est que la culture soit perçue comme un supplément d’âme, alors qu’elle constitue un levier structurant de justice sociale et de démocratie locale.
Rappelons-nous cette forte idée souvent attribuée à Churchill : quand on lui aurait proposé de couper dans les budgets de la culture pour financer l’effort de guerre, il aurait répondu, « Then what are we fighting for? ».
Si cette formulation ne figure pas dans ses discours (elle est largement demystifiée), elle condense bien un sentiment réel qu’il a exprimé en 1938, à la Royal Academy :« The arts are essential to any complete national life… Ill fares the race which fails to salute the arts with the reverence and delight which are their due. »
Économie locale
Les faits
L’économie locale bénéficie fortement des choix d’investissement de la Métropole.
Le budget 2025 affiche un effort soutenu dans les domaines de la transition écologique, du logement, de l’eau ou encore des mobilités, autant de leviers qui irriguent l’économie réelle.
Lyon Métropole Habitat investit 146 millions d’euros en 2024, créant des effets d’entraînement dans la filière du bâtiment, l’ingénierie locale et les PME du territoire.
Des dispositifs d’accompagnement sont également mis en place pour les bailleurs sociaux, les copropriétés, ou encore les professionnels de l’énergie (rénovation, performance thermique, etc.).
L’analyse
La commande publique joue ici un rôle d’amortisseur économique, voire de moteur.
En soutenant les filières locales et durables, la Métropole permet à l’économie de rebondir malgré les crises inflationnistes ou énergétiques.
Ce modèle d’économie territoriale par l’investissement reste cependant dépendant de certains facteurs exogènes : coûts du foncier, complexité administrative, aléas réglementaires.
Le défi à moyen terme sera de faire émerger un tissu économique autonome, ancré dans la transition, capable de prendre le relais du seul volontarisme public.
Agriculture
Les faits
La Métropole a engagé 10 millions d’euros pour le soutien à l’agriculture de proximité entre 2020 et 2026.
Elle accompagne aujourd’hui environ 230 agriculteurs sur son territoire, et a déjà permis que 19 % des surfaces agricoles soient conduites en agriculture biologique.
L’objectif fixé est d’atteindre 25 % d’ici 2026.
Des actions concrètes sont menées : ferme semencière expérimentale, soutien à l’installation de maraîchers bio, appui technique, aides à la structuration des circuits courts, politique foncière via l’Office foncier agricole (2,5 M€ mobilisés).

L’analyse
L’action agricole de la Métropole s’inscrit dans une vision systémique : relocaliser la production alimentaire, sécuriser les exploitations existantes, et faire du bio un levier de résilience.
Ces choix politiques sont cohérents avec la stratégie climatique, mais aussi avec les impératifs de justice sociale et de souveraineté alimentaire.
Le cap est clair, les moyens sont mobilisés, mais les défis restent nombreux : accès au foncier, prix de vente, renouvellement des générations, logistique des circuits courts.
Il ne suffit pas de subventionner l’agriculture locale, encore faut-il structurer durablement les débouchés économiques pour garantir sa viabilité.
Inclusion sociale / précarité
Les faits
La Métropole de Lyon consacre plus de 838 millions d’euros à ses dépenses sociales, soit 23,1 % du budget de fonctionnement, un des taux les plus élevés parmi les grandes métropoles françaises.
Cela recouvre une diversité d’actions : RSA, protection de l’enfance, accompagnement des personnes âgées, insertion professionnelle, handicap, aide alimentaire…
Le Plan d’insertion métropolitain a été révisé en 2022 pour mieux répondre aux situations de précarité post-Covid.
Il prévoit un accompagnement renforcé, des parcours individualisés vers l’emploi, et des partenariats avec les acteurs de l’ESS (Économie sociale et solidaire).
Des actions spécifiques sont menées sur l’accès au droit, l’accueil des publics vulnérables (exilés, sans-abris), le soutien aux associations caritatives, et la prévention de l’isolement.
Un Fonds d’urgence sociale a également été mobilisé en période de crise énergétique.
L’analyse
La politique sociale métropolitaine reste massive, continue et multiforme.
Contrairement à l’idée reçue selon laquelle les écologistes délaisseraient le social au profit du climat, les chiffres et les actions montrent l’inverse.
L’approche actuelle met l’accent sur l’insertion et la prévention plutôt que la seule assistance : cela reflète une stratégie de long terme, en lien avec les autres priorités (logement, santé, transition).
Certaines limites demeurent :
- Les publics les plus éloignés des droits (personnes sans-papiers, jeunes précaires) restent difficilement atteignables.
- La lisibilité de l’action pourrait être renforcée par des indicateurs publics plus précis, notamment sur les effets des politiques d’insertion.
Mais globalement, le pilier social du projet écologiste est bien réel, même s’il est parfois moins médiatisé.
Gouvernance / démocratie locale
Les faits
Depuis 2020, la majorité écologiste a mis en place plusieurs dispositifs pour renforcer la participation citoyenne :
- Conseils de développement, assemblées citoyennes, Budgets participatifs dans certaines communes.
- Expérimentations de démocratie locale : ateliers ouverts, concertations sur les grands projets (ZFE, voirie, plan canopée…).
- Transparence budgétaire accrue, publication des grandes orientations et PPI de manière plus lisible pour les citoyens.
La Métropole a également lancé des démarches de co-construction avec les associations et les acteurs de terrain, notamment sur les questions de solidarité, d’urbanisme et de transition écologique.
Enfin, certains projets emblématiques (Voies Lyonnaises, végétalisation) ont été modifiés ou adaptés suite à des retours citoyens.
L’analyse
L’approche démocratique du mandat actuel repose sur une ouverture accrue aux citoyens, à la fois sur le fond (choix budgétaires, grands projets) et sur les méthodes (concertation, transparence, co-construction).
Ce n’est pas une révolution, mais une inflexion notable par rapport aux mandats précédents : plus de place aux expressions citoyennes, plus de lisibilité des choix politiques, et une volonté de sortir du tout-technocratique.
Cependant, la démocratie participative reste fragile :
- Tous les publics ne s’en saisissent pas de la même manière.
- Le temps politique long ne s’accorde pas toujours avec l’urgence des attentes.
- Et la participation n’est pas toujours synonyme de décision partagée.
- Mais l’effort est là, dans une période où le fossé entre citoyens et institutions s’aggrave ailleurs.
Mais l’effort est là, dans une période où le fossé entre citoyens et institutions s’aggrave ailleurs.
Et parfois, cet effort se traduit par des actes concrets, simples mais puissants :
Tous les collèges de la Métropole sont désormais équipés de distributeurs de protections périodiques gratuites.
Un engagement clair contre la précarité menstruelle, au service de l’égalité et du bien-être des jeunes filles.
Éducation / jeunesse
Les faits
Les compétences éducatives de la Métropole sont limitées, mais elle intervient dans plusieurs domaines clés :
- Collèges :
Rénovation thermique, végétalisation, aménagements extérieurs pour limiter les îlots de chaleur. - Petite enfance :
Création de places en crèche, soutien aux structures d’accueil, extension des horaires adaptés aux familles. - Jeunesse et engagement :
Soutien à des projets associatifs, dispositifs d’accompagnement vers l’emploi ou la formation, actions d’éducation à l’environnement. - Rues des enfants :
Sécurisation des abords d’écoles, réduction du trafic, amélioration du cadre de vie scolaire.
Certaines communes pilotées par des mairies écologistes (Lyon, Villeurbanne) ont également mis en œuvre des projets éducatifs ambitieux, comme les cours oasis, les temps de respiration scolaire, ou la découverte de la nature en milieu urbain.
L’analyse
Malgré la compétence partielle sur l’éducation, la Métropole et les villes écologistes ont intégré la jeunesse dans leur stratégie de transition :
- En travaillant sur les environnements d’apprentissage (bâtiments, abords, climat scolaire).
- En développant des passerelles entre écologie, citoyenneté et insertion.
- En considérant les jeunes comme acteurs, pas seulement comme bénéficiaires.
Ce volet reste encore peu visible dans les bilans officiels, mais constitue une trame de fond importante du projet municipal : celle d’une génération outillée, formée, et placée au cœur des transformations à venir.
Plaintes des commerçants, contexte et limites
Il est vrai que de nombreux commerçants du centre-ville de Lyon expriment un sentiment fort de difficulté : selon le baromètre ‘My Presqu’Île’, 65 % des boutiques de la Presqu’Île rapportent une baisse de leur chiffre d’affaires entre les 1ers semestres 2023 et 2024, parfois supérieure à 20 %.
De plus, le taux de vacance commerciale à Lyon est passé de 4,2 % à 6,2 % entre 2021 et 2024, ce qui alimente le ressenti d’un centre-ville en perte de vitalité.

Cependant, il serait erroné d’imputer ces baisses exclusivement aux politiques écologistes. D’autres facteurs importants interviennent : les travaux de voirie, la concurrence des zones commerciales périphériques, l’essor du commerce en ligne, la hausse des loyers et des charges, les évolutions de consommation après la pandémie.
Les politiques comme les ZFE ou piétonnisation, si elles peuvent peser sur l’accessibilité au court terme, sont souvent mises en œuvre avec mesures d’accompagnement (signalisation, stationnement, aides aux livraisons, soutien aux petits commerces).
On ne dispose pas encore de données consolidées universitaires ou statistiques publiques permettant d’isoler l’impact exact de chaque politique écologique sur le chiffre d’affaires des commerçants en centre-ville, ce qui reste un angle à creuser pour rendre le débat plus objectif.
Il faut également noter que la presse locale lyonnaise, très majoritairement hostile à la municipalité écologiste, joue un rôle d’amplification de ces plaintes, contribuant à renforcer le sentiment d’effondrement commercial sans toujours en mesurer les causes réelles.
Conclusion
Quand la gauche gouverne vraiment
Pendant des années, on a dit que l’écologie, c’était joli dans les discours, mais impraticable dans la vraie vie.
Qu’une gauche exigeante n’avait pas les épaules pour gérer une métropole.
Qu’entre transition et rigueur budgétaire, il fallait choisir.
À Lyon, ces idées reçues ne tiennent plus.
Ce bilan le montre :
Les écologistes, avec leurs alliés de gauche, ont investi massivement dans la transition, sans creuser la dette.
Ils ont fait reculer la pollution, soutenu le logement social, renforcé les protections sociales, accompagné les filières locales, et relocalisé une part de l’économie.
Ils l’ont fait sans renier leurs principes, sans pactiser avec les lobbies, sans mettre sous le tapis les urgences sociales.
Autrement dit, ils ont gouverné à gauche.
Pas à coups de symboles, mais en transformant concrètement les priorités publiques.
Pas en agitant des totems, mais en investissant dans l’essentiel : la santé, le logement, la justice sociale, le climat.
Dans un monde saturé de renoncements, cette constance, cette méthode, ce cap valent bien plus qu’un slogan de campagne.
Ils prouvent que la gauche peut gouverner autrement et gouverner bien.
Sources & bibliographie
- Rapport de mi-mandat – Métropole de Lyon (2023)
- Rapport de mi-mandat – Ville de Lyon (2023)
- Budget primitif 2025 – Métropole de Lyon
- Atmo Auvergne-Rhône-Alpes – Données sur la qualité de l’air (2024)
- Observatoire régional de l’air – EQIS Santé publique & pollution
- Inventaire GES – Métropole de Lyon, Données 2015–2024
- Rapports Transition & Résilience – Métropole de Lyon (2021–2024)
- Lyon Métropole Habitat – Rapports d’activité et budget 2024
- Office foncier agricole – Présentation et budget prévisionnel
- Publications SYTRAL Mobilités – Investissements et extension réseau TCL
- Base nationale des finances locales – Collectivités territoriales
Une réaction, un désaccord, une idée ?
Cliquez sur la bulle 💬 rose en bas à gauche pour laisser un commentaire.
Je lis tout. Je réponds toujours.
Envie de faire circuler cet article ?
Vous pouvez le partager via les icônes en haut ou en bas de cette page.
Envie de suivre les prochaines publications ?
→ S’abonner à la newsletter

Léon Chelli arpente les mondes de l’automobile et des énergies renouvelables à l’épreuve de la transition écologique.
Il y déchiffre mutations industrielles et stratégies de marché avec la lucidité un peu sauvage d’un promeneur qui choisit ses propres sentiers.
Il explore les transitions avec une vision systémique, entre ironie assumée et clarté analytique.