Approvisionnement batteries : la couverture souveraine face au risque géopolitique
Quand la matière devient pouvoir, la dépendance n’est plus un risque : c’est une reddition différée.
Le risque n’est plus une hypothèse
Pendant des années, on a parlé du « risque géopolitique » comme d’une abstraction.
Il n’en est rien.
Le raffinage intermédiaire des métaux critiques pour batteries, lithium, nickel, cobalt et graphite, dépend à plus de 80 % de la Chine, tandis que la fabrication des matériaux actifs, cathodes et anodes, y atteint jusqu’à 97 %, selon l’Agence internationale de l’énergie.
Autrement dit, une seule décision prise à Pékin peut désorganiser la moitié de la chaîne mondiale des batteries.
Cette dépendance ne s’est pas construite par naïveté : elle résulte de vingt ans d’optimisation industrielle, où l’Occident a préféré la baisse des coûts à la maîtrise stratégique.
Le résultat est simple : l’Europe a externalisé son raffinage, ses usines chimiques, ses déchets… et sa souveraineté.
L’alerte ne date pas d’hier.
En 2023, la Chine a déjà limité les exportations de graphite naturel et synthétique, puis instauré des licences sur le gallium et le germanium.
Le signal était clair : l’accès à la matière devient un instrument diplomatique.
Quand la mondialisation devient dépendance
On confond souvent économie de marché et économie de dépendance.
La première suppose la fluidité des échanges ; la seconde, leur asymétrie.
La Chine ne se contente pas de produire : elle absorbe.
Avec plus de 11 millions de véhicules électriques vendus en 2024, elle est devenue son propre débouché.
Son industrie consomme prioritairement pour elle-même : 1,4 milliard d’habitants, une stratégie d’électrification nationale, et un appareil d’État qui planifie.
L’Europe, avec 450 millions d’habitants, dépendante pour 85 % de ses cellules et pour 97 % de ses anodes, ne peut rivaliser ni en volume ni en vitesse.
Elle reste une puissance d’assemblage, pas de production.
Les chiffres du risque
Avant d’envisager la riposte, il faut mesurer l’ampleur du déséquilibre. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : la Chine concentre les moyens, l’Europe accumule les retards.
| Indicateur | Chine | Union européenne | Source / Objectif |
|---|---|---|---|
| Raffinage lithium, nickel, cobalt | ~80 % mondial | < 5 % | IEA, Critical Minerals Outlook 2024 |
| Matériaux actifs cathode | ~90 % | ~3 % | IEA |
| Matériaux actifs anode (graphite) | ~97 % | quasi nul | Benchmark Minerals Intelligence |
| Production de cellules | 85 % | 7 % | Transport & Environment 2024 |
| Part du BEV dans les ventes 2024 | > 35 % | 12 % | ACEA / CPCA |
| Population | 1,4 milliard | 450 millions | ONU |
| Cibles CRMA 2030 | — | 10 % extraction / 40 % transformation / 15 % recyclage | Commission européenne |
En clair : la Chine concentre la capacité, la demande et la planification.
L’Europe, elle, dépend d’une équation qu’elle ne maîtrise plus.
Face à cette asymétrie, l’Europe s’est réfugiée dans un discours d’économie circulaire censé inverser la dépendance. En théorie, du moins.
Le mythe du recyclage-sauveur
Face à cette réalité, le réflexe européen est souvent de brandir le recyclage comme solution miracle.
C’est un progrès, pas une assurance.
Les volumes de batteries usagées réellement disponibles restent modestes : la majorité des flux recyclés avant 2030 proviennent des rebuts de production, pas du parc automobile.
Les gisements massifs d’« end-of-life » n’arriveront qu’après 2032–2035, quand la première génération de véhicules électriques atteindra la fin de vie.
Prenons un exemple : un pack de 60 kWh contient environ 54 kg de graphite.
Trois millions de véhicules électriques produits par an en Europe représentent donc 160 000 tonnes de graphite consommé chaque année.
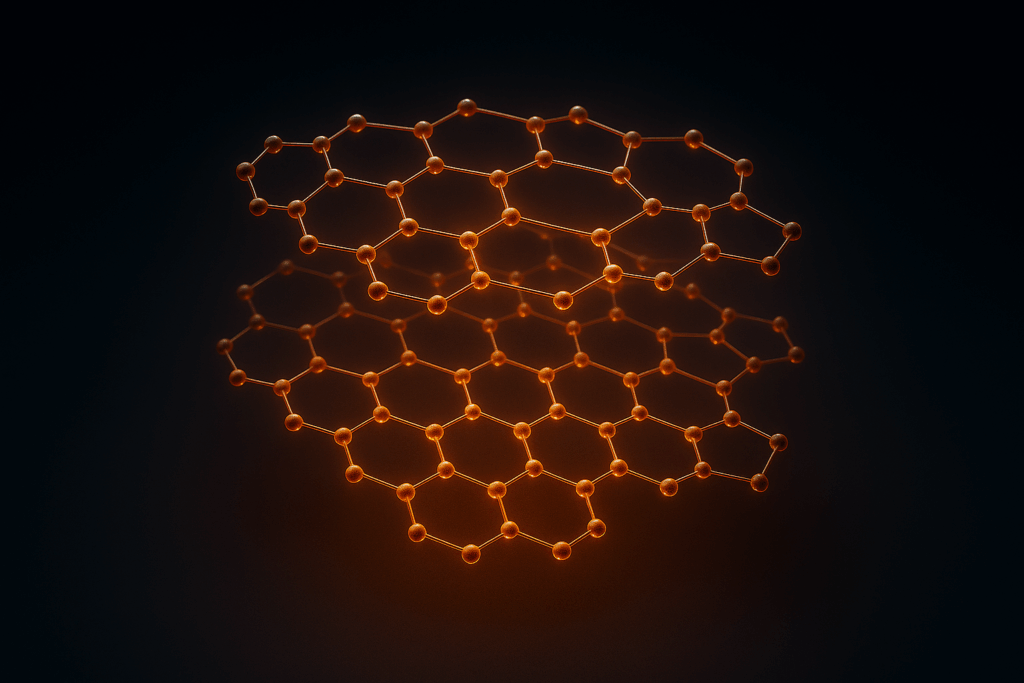
Chaque cellule européenne dépend encore de ce réseau invisible, raffiné à 97 % en Chine.
Or, le recyclage européen n’en couvre aujourd’hui même pas 5 %.
Northvolt Revolt Ett vise 125 kt/an à terme, Umicore en traite 7 kt/an.
L’ordre de grandeur parle de lui-même : le recyclage amortit, il ne compense pas.
Il joue le rôle d’une couverture partielle, comparable à celle qu’un investisseur place pour réduire sa volatilité : il protège contre les secousses, pas contre la dépendance structurelle.
Construire une couverture souveraine
Diversifier les offtakes* et co-investir dans l’amont
Sécuriser les flux hors Chine : nickel d’Indonésie, lithium d’Australie ou d’Amérique du Sud, graphite du Mozambique ou du Canada.
Mais la clé est d’aller au-delà des contrats : co-investir dans les sites miniers, avec clauses de livraison prioritaire pour l’Europe.
*Contrats d’achat à long terme conclus en amont de la production, entre un constructeur et un fournisseur de matières premières (souvent pour le lithium, le nickel ou le graphite)
Raffiner et transformer en Europe
Les objectifs du Critical Raw Materials Act (CRMA) sont clairs :
10 % extraction, 40 % transformation, 15 % recyclage d’ici 2030, et moins de 65 % de dépendance à un seul pays.
Cela suppose de relancer le raffinage chimique sur le sol européen, avec énergie bas-carbone, logistique intégrée et acceptabilité politique.
Sans cette étape, toute gigafactory n’est qu’un atelier d’assemblage.
Constituer un stock stratégique
Stocker non pas du minerai, mais des sels raffinés : LiOH, Li₂CO₃, NiSO₄, CoSO₄, matériaux d’anode.
Objectif : 90 à 180 jours de couverture pour les usines critiques.
Une pratique courante dans la défense, absente de l’industrie civile.
C’est pourtant la seule parade à une fermeture brutale des frontières.
Adapter la chimie, pas seulement la politique
Réduire le cobalt (NMC 811 ou NMC 9½½), favoriser les chimies LFP pour les usages compatibles, sodium-ion pour le stationnaire ou les petits véhicules.
Chaque choix de chimie est un acte géopolitique : moins on dépend d’un métal sous influence, plus la souveraineté devient tangible.
Repenser la logistique
Sécuriser les routes logistiques et anticiper les ruptures d’acheminement : la matière stratégique n’a de valeur que si elle circule.
Mais une couverture, aussi bien pensée soit-elle, ne suffit pas si la vision reste fragmentée.
L’Europe à la croisée des choix
La dépendance n’est pas seulement économique : elle est philosophique.
Elle traduit un modèle de confort fondé sur l’illusion d’un approvisionnement infini.
Mais la matière est redevenue politique, comme au XIXᵉ siècle.
Le lithium, le nickel, le cobalt, le graphite ne sont plus des lignes comptables : ce sont des instruments de puissance.
Le recyclage souverain ne suffira pas s’il n’est pas intégré dans une stratégie systémique.
Ce qu’il faut, c’est une couverture de portefeuille : diversification, transformation, stockage, substitution.
L’Europe n’a pas besoin d’un nouveau discours sur la souveraineté : elle a besoin d’un bilan consolidé du risque matière, actualisé chaque trimestre.
L’approvisionnement batteries n’est qu’un symptôme d’un déséquilibre plus large, celui du contrôle des matières critiques.
Ce siècle ne sera pas celui des marchés, mais celui des métaux.
Et la souveraineté, désormais, se mesure en tonnes.
Ces cinq fils rouges (Sillages) traversent mes publications :
Cartographie des segments, Distribution & Économie, Marketing du VE, Marques & Modèles, Technologies du VE.
Une réaction, un désaccord, une idée ?
Cliquez sur la bulle 💬 rose en bas à gauche pour laisser un commentaire.
Je lis tout. Je réponds toujours.
Envie de faire circuler cet article ?
Vous pouvez le partager via les icônes en haut ou en bas de cette page.
Envie de suivre les prochaines publications ?
→ S’abonner à la newsletter

Léon Chelli arpente les mondes de l’automobile et des énergies renouvelables à travers la transition écologique. Il y déchiffre mutations industrielles et stratégies de marché avec la lucidité un peu sauvage d’un promeneur qui choisit ses propres sentiers.
Il explore les transitions avec une vision systémique, entre ironie assumée et clarté analytique.







